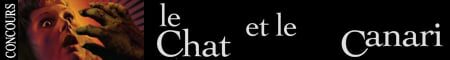Cette année, compétitions et rétrospectives se rejoignaient autour d’un fil conducteur de l’insoumission à un ordre établi, à un formatage, à des normes dominantes. Qu’il s’agisse des cinéastes ou des protagonistes de leurs films, durant ces Hallucinations Collectives 2024, toutes et tous refusent de rester passifs ou tout du moins cessent de l’être. Peu importe le pays, l’époque, le genre… La thématique Haro sur l’autorité est venue implicitement imbiber les différentes strates de la programmation, le festival étant plus que jamais en phase avec son désir de proposer un autre cinéma et, en fin de compte, un autre monde. Retour sur une semaine hallucinée et toutes les séances auxquelles nous nous sommes rendus.
Concrete Utopia – Um Tae-hwa (2024) – Ouverture

Concrete Utopia – Copyright Lotte Entertainment 2024
Post-apocalyptique sud-coréen, Concrete Utopia relate, après qu’une catastrophe ait rayé le pays de la carte, la construction d’une nouvelle société dans un immeuble flambant neuf de Séoul qui tourne au drame. Récit qui repose uniquement sur son allégorie (pas des plus subtiles avouons-le), le film ne se montre que ponctuellement à la hauteur de ses promesses de départ. La faute à une durée excessive, une tendance aux couches narratives superflues (auxquelles s’ajoutent des flashbacks trop explicites) et une réalisation inégale pâtissant, entre autres, d’une photographie numérique assez ingrate. Même si quelques bonnes idées parviennent à poindre çà et là (le mystère maintenu autour de la nature de la catastrophe, les spots de propagande digne d’un Verhoeven), le tout très avare en spectacle et excessivement bavard, n’est au final qu’un produit quelconque de plus, qui se suit d’un œil distrait. Force est de constater que depuis que Parasite l’a placé sur le devant de la scène, le cinéma sud-coréen peine à se renouveler et à révéler de nouvelles générations d’auteurs. Ou alors, à l’instar de Lee Byun-hun, qu’on prend plaisir à retrouver ici en souvenir de JSA et autres Bittersweet Life, peut-être a-t-il prématurément pris un coup de vieux ?
La Maison aux fenêtres qui rient – Pupi Avati (1976) – Cabinet de Curiosités
La Maison aux fenêtres qui rient – Copyright Le Chat qui Fume 2024
Longtemps invisible, La Maison aux fenêtres qui rient bénéficie, près de cinquante ans après sa sortie, d’une restauration, ce qui ajoute presque une pointe d’ironie au vu du point de départ de son scénario. Stefano débarque dans un petit village pour assurer la restauration d’une fresque macabre, avant d’être interpellé par la personnalité du peintre décédé et la nature de ses œuvres. Giallo rural ou variation du genre, mêlant le théorique et le pratique, le mental et le concret, ce cinquième long-métrage de Pupi Avati se rapprocherait par son cadre de La Longue nuit de l’exorcisme de Lucio Fulci dont il peut constituer le cousin poétique. Les deux films partagent une même vision impitoyable de la campagne italienne, dépeinte comme un faux havre de paix et véritable lieu de perdition. À la faveur (ou défaveur selon les sensibilités) d’un rythme éthéré, entre onirisme et exploration de la folie du héros, Avati s’emploie à relire et retravailler les peurs enfantines et les fables transalpines effrayantes qui ont bercées sa propre jeunesse, tout en allant flirter avec le gothique. Sur ce dernier point, il rappelle notamment à Ne Vous Retournez pas de Nicolas Roeg. Sa propension à entremêler les couches et les degrés d’interprétation, à harmoniser les arts et les sources d’inspiration, accouche d’un ensemble singulier et sidérant. Cru et cérébral, méta dans sa dimension la plus noble, c’est à dire pour interroger en permanence la portée des actes de son protagoniste, mais aussi le geste même du cinéaste. Le suspense et la finalité de l’intrigue deviennent secondaires face aux questions presque philosophiques que soulèvent des visions fulgurantes et habitées. La Maison aux fenêtres qui rient se pose en monument oublié d’un âge d’or créatif qui n’en finit plus d’être exhumé et réexploré. Bientôt disponible dans une édition haute-définition de premier choix chez Le Chat qui fume, qu’il conviendra à tous les amoureux du genre de se procurer.
The Fireworks Woman – Wes Craven (1975) – Cabinet de Curiosités
The Fireworks Woman
Longtemps invisible, l’unique porno réalisé par Wes Craven (sous le pseudonyme d’Abe Snake) afin de financer La Colline a des yeux, fut une projection événement à la faveur d’une copie d’un collectionneur privé. Histoire d’amour interdite entre un frère et une sœur, il contient en creux toutes les obsessions du cinéaste. La mise à mal du modèle familial traditionnel, les rêves comme autre réalité (prémisses de Freddy) et une attaque en règle contre les valeurs américaines. Ici, le 4 juillet se change en orgie libératrice, point d’orgue d’un film étonnant, où les scènes de sexe ne sont pas les climaxs attendus. Le réalisateur (qui fait une apparition dans un rôle méphistophélique) emballe le tout avec élégance et propose même de vraies idées de cinéma, à l’image d’une séquence de plaisir solitaire et onirique.
Themroc – Claude Faraldo (1973) – Haro sur l’autorité !

Themroc – Copyright Tamasa 2020
Ce démentiel Themroc, réalisé par Claude Faraldo en 1973, et adapté de l’une de ses propres pièces, s’impose comme un jouissif doigt d’honneur adressé à une société française encore sclérosée malgré la révolution de mai 68. Dans un monde dit civilisé, où de « gentils prolétaires » sont assignés à des tâches absurdes et débilitantes, où des sous-titres hilarants définissent la place des uns et des autres, où l’on grogne, éructe, tousse, plus que l’on ne se parle, le retour aux instincts primaires semble devenu la seule planche de salut. Un long-métrage fou, anarchiste, libertaire (et libertin), où se croisent Michel Piccoli, Henri Guybet, et les acteurs montants du Café de la gare, Coluche, Patrick Dewaere et Miou-miou en tête.
Le Cœur fou – Jean Gabriel Albicocco (1970) – Cabinet de curiosités
Le Cœur fou – Copyright Le Chat qui fume 2024
Il est des œuvres devenues légendaires par leur rareté et leur invisibilité depuis des décennies. Le Cœur fou fait partie de ceux-là, aux côtés, entre autres, de La Traque. Comme ce dernier, le long-métrage réalisé par Jean-Gabriel Albicocco (l’un des fondateurs de la quinzaine des réalisateurs et ancien assistant de Jules Dassin) aura d’ailleurs prochainement droit à une édition chez Le Chat qui Fume. Histoire d’un journaliste partant en cavale avec une psychopathe pyromane dont il va tomber amoureux, le film s’impose comme un objet résolument à part dans le paysage cinématographique français des années 70. Récit d’une passion déraisonnée préfigurant les outrances de Zulawski, dans une forme proprement hallucinante, composée en grande partie de longs plans à la courte focale, il a marqué plus d’un cinéaste, un certain Fabrice Du Welz en tête. Visuellement sublime et flamboyant, graphique et atmosphérique (à l’instar de ce son lancinant et omniprésent), il ne tombe pas pour autant dans le maniérisme vain que certains lui ont reproché en son temps. A contrario, en suivant deux individualités en rupture avec la société, dans un jusqu’au-boutisme irrationnel et cohérent, le cinéaste cherche à s’extraire des carcans du cinéma hexagonal. Une position qu’il paiera, en témoignent les controverses qui ont accompagné la sortie, et la disparition d’Albicocco lui aussi mis au ban de l’industrie. Il n’est jamais trop tard pour réparer une injustice et réhabiliter une œuvre, hurler passionnément à quel point Le Cœur fou est sublime et occupera désormais une partie de nos discussions cinéphiles.
Steak – Quentin Dupieux (2007) – Absurdomanies

Steak – Copyright Studio Canal 2024
Steak est d’abord entré dans l’Histoire comme un malentendu coupable. Piteusement vendu telle une énième comédie avec Éric & Ramzy, qui venaient d’enchaîner les peu glorieux Double Zéro et Les Dalton, marketé en grande pompe par un Thomas Langmann incapable de se rendre compte de ce qu’il avait sous la main et sorti de manière opportuniste pendant la fête du cinéma 2007 : rien ne laissait présager une réelle démarche artistique. En conséquence, il fit l’objet d’un revers critique et public, à quelques exceptions non négligeables près, qui n’auront pas peur d’en chanter les louages : Les Cahiers du cinéma, Libération, Télérama, Chronic’art. Confessons qu’après avoir été troublé par l’étrangeté dérangeante et hilarante de l’objet, avoir fait partie de ses défenseurs zélés, à une époque où cela était suspect. Dix-sept ans plus tard, Quentin Dupieux est connu et reconnu, pour preuve, il vient de signer ses deux plus gros succès avec Yannick et Daaaaaali !, mais Steak est-il pour autant réhabilité ? Si la réponse doit malheureusement rester négative, lentement mais sûrement, le temps répare cet affront originel.

Steak – Copyright Studio Canal 2024
En connaissance de l’œuvre ultérieure de Quentin Dupieux, tout ce qui fera sa marque par la suite, était déjà contenu dans ce magistral coup d’essai. Un univers singulier et cohérent, atemporel dans la mesure où cettte espèce de futur rétro brouille constamment nos repères, partiellement insituable, subsiste un flou géographique (que sont ces États-Unis où tout le monde parle français ?). Le cinéaste crée une langue surréaliste, absurde et pourtant bien concrète. D’abord littéralement, en abordant directement la question du langage au cours de l’un des premiers dialogues : « Ça se dit plus ? Ça se dit encore ? », imposant des rites et salutations propres au clan des Chivers. Ce nom, d’ailleurs constitue un exemple éloquent parmi d’autres, il renvoie à David Cronenberg, une influence qui n’a rien d’innocent dans un contexte de modifications corporelles multiples. En somme, Dupieux élabore un cinéma très personnel et référencé, au sein duquel, des ponts et filiations existent, de Buñuel à Blier, mais où le dernier mot revient toujours à l’auteur naissant. Teen-movie dystopique et satire visionnaire du culte de l’apparence, Steak refuse le rire gratuit, la violence suggérée (et implicitement banalisée) de son prologue est un indicateur : l’humour est toujours emprunt d’une forme de gravité. C’est aussi un pur film d’acteurs, réinventant Eric & Ramzy, la plupart du temps séparés à l’écran, mettant en exergue les spécificités intrinsèques des deux hommes. Il amorce le tournant créatif que suivra peu après le premier (Platane, Problemos,…), roi de l’humour officieux du paysage francophone, tout en esquissant le potentiel dramatique du second, qui ne manquera pas de se diversifier après les années 2010. Surtout, l’auteur convie une partie de sa famille musicale et importe ainsi son univers initial au cinéma : Kavinsky (« Le dernier arrivé est fan de Phil Collins » c’est lui) bien avant sa notoriété post-Drive, Sebastian et surtout Sébastien Tellier absolument génial. N’ayons pas peur de le dire, il s’agit possiblement de la meilleure comédie française de la première décennie 2000, et a minima, l’acte fondateur ultra abouti d’un cinéaste devenu peu à peu un protagoniste majeur dans le cinéma hexagonal.
Napoleon Dynamite – Jared Hess (2004) – Absurdomanies

Napoleon Dynamite – Copyright Fox Searchlight 2024
Jared Hess est un nom obscur en France, et pour cause ses films les plus notables ont eu droit à des sorties techniques voir directement en vidéo. C’est notamment le cas de son coup d’essai, en dépit d’un véritable phénomène aux Etats-Unis (pour les amateurs de chiffres : 400 000 $ de budget pour 46, 1 millions $ de recettes), Napoleon Dynamite. Dernière grande comédie américaine des années 2000, pré-Judd Apatow (réalisateur et producteur) qui crée à sa manière la jonction entre le cinéma des frères Farelly et celui de l’auteur de Funny People, alliant goût du décalage, une attache profonde pour ses personnages et observations fines. Jared Hess développait et étendait avec ce premier long, l’univers qu’il avait esquissé deux ans plus tôt en court et N&B dans Peluca , déjà avec Jon Heder.
Étendard d’un cinéma indépendant libre, s’affirmant hors des conventions, Napoleon Dynamite révèle simultanément un acteur et un réalisateur. Jamais dans la moquerie ou la recherche du gag facile, la comédie naît d’une étude de caractères fine, où la bizarrerie et le refus de la norme sont autant des vecteurs d’émancipation que les déclencheurs de répliques et passages pour beaucoup devenus cultes. Hess ne rit pas de ses personnages mais avec eux, faisant preuve d’une inventivité et d’une acuité souvent irrésistibles, auxquelles s’ajoutent les interprétations aussi décalées qu’investies. C’est aussi une pertinente auscultation de la figure du geek, qui interroge autant sa place dans la société que dans le cinéma américain, vingt ans après Revenge of the Nerds, dix ans après Clerks et surtout avant sa prise de pouvoir au sein de l’industrie de The Social Network à Ready Player One.

Napoleon Dynamite – Copyright Fox Searchlight 2024
Au-delà du plaisir immense de redécouvrir Steak et Napoleon Dynamite, ce double programme Absurdomanie présentait implicitement deux carrières en miroir, de deux grands espoirs de la comédie aux trajectoires différentes. Quand Quentin Dupieux n’a cessé de monter en puissance jusqu’à être aujourd’hui attendu pour l’ouverture du Festival de Cannes avec Le Deuxième acte, Jared Hess après un démarrage en trombe bientôt suivi du succès de Super Nacho, n’a pas survécu à l’échec du mal-aimé et pourtant attachant Gentlemen Broncos, il est peu à peu rentré dans le rang. Il sera en 2025 à la réalisation d’une adaptation du jeu vidéo Minecraft pour laquelle il retrouvera Jack Black face à Jason « Aquaman » Momoa.
En Boucle – Junta Yamaguchi (2024) – Compétition

En Boucle – Copyright Cinéma Comoedia
Sur le même principe que son prédécesseur, Beyond the Infinite Two Minutes et avec davantage de moyens, Junta Yamaguchi, s’attelle de nouveau avec En Boucle, à creuser un concept de boucle temporelle d’une durée de deux minutes. Ici, le personnel et les hôtes d’un établissement hôtelier au cœur d’un petit village, sous les flocons de neige et au bord d’une rivière, tentent de s’extraire d’une temporalité courte se répétant inexplicablement et inlassablement. En changeant d’échelle de production, Yamaguchi, conserve une forme de candeur et de plaisir au moment d’explorer son concept et tenter de s’affranchir de ses limites inhérentes (l’inévitable répétition). Mieux, au moins dans ses intentions, il manifeste une énergie considérable pour dépasser le conceptuel et tendre vers l’existentiel. Comment faire exister et vivre des personnages prisonniers d’un espace-temps et d’un décor voués à rester inchangés ? Comment approfondir quoi que ce soit en étant restreint à seulement deux minutes ? À l’exception d’une résolution vouée à être anecdotique et décevante, en dépit de la sensation de version upgradée de son premier long-métrage, le cinéaste parvient à se montrer inventif dans un exercice conscient de ses propres limites. Une petite chose à la fois attachante et oubliable.
When Evil Lurks – Demián Rugna (2024) – Compétition

When Evil Lurks – Copyright Charades / ESC 2024
Du sang, de la crasse et de la sueur, voici en quelques mots le programme délicieusement dégoûtant concocté par l’argentin Demián Rugna, de retour sept ans après le remarqué Terrified. Rednecks sud-américains, récit de possession démoniaque revisité à la sauce ultra gore, enfants tour à tour inquiétants et malmenés… When Evil Lurks n’entend pas révolutionner le genre mais se réapproprier intelligemment et avec personnalité les codes qu’il investit. Proposition solide et généreuse, dont les éventuelles imperfections ou maladresses sont très secondaires, face à des qualités hautement valorisables. Quel plaisir que de voir un film d’horreur de ce type à la fois très tenu dans sa forme, qui n’a pas peur de bousculer, quitte à en passer par des images vraiment choquantes (mais jamais gratuites) tout en démontrant en parallèle une science du hors-champ notable, une maîtrise totale de l’espace. Dans ce récit de laissés-pour-compte qui refusent d’abandonner et de s’abandonner, Demián Rugna exploite un territoire hautement cinégénique (la campagne argentine) que peu utilisé par le cinéma de genre, et c’est aussi là qu’il se démarque, en digérant des références (The Strangers, Les Révoltés de l’an 2000) qu’il détourne ainsi géographiquement et temporellement. Enfin, soulignons notre satisfaction de voir un projet non-formaté, qui se fiche de la bienséance et des injonctions momentanées, pour proposer ses propres règles et un retour aux sources. Ici, l’antihéros a un passé violent et n’est guère sympathique, c’est pourtant à ses côtés qu’il faut tenter de survivre dans ce retour à une sauvagerie la plus viscérale (l’arme blanche est privilégiée à l’arme à feu). Ça secoue, ça effraie et ça fait un bien fou, même si l’on un peu sonné. Espérons que Rugna ne soit pas contraint d’attendre sept ans avant de revenir !
The Boxer’s Omen – Chih-Hung Kuei (1983) – Carte Blanche à Robert Morgan
The Boxer’s Omen – Copyright Arrow 2022
The Boxer’s Omen a un immense mérite, il permet à son spectateur de comprendre très vite s’il va adhérer ou rester totalement extérieur à la proposition. Passé une introduction relativement réaliste rappelant au cinéma hongkongais de la Catégorie III (on pense à Story of Ricky, diffusé quatre éditions en arrière), le temps d’un combat de boxe joyeusement décomplexé, le film envoie (avec la manière) se faire voir la narration, le bon sens et le bon goût. Chih-Hung Kuei s’adonne alors à une succession de climax visuels et invoque de manière totalement désinhibée délires esthétiques à base de magie noire, d’insectes et d’animaux en tous genres. Gigantesque orgie filmique ou série Z déviante et généreuse, mais finalement peu jouissive ? C’est assurément un concentré d’hallucinations singulières, mais nous nous inscrivons plutôt dans la deuxième catégorie, éreinté par un spectacle plus usant qu’excitant.
Property – Daniel Bandeira (2024) – Compétition

Property – Dark Star Pictures 2023
Sur la base d’une opposition frontale entre des ouvriers agricoles et un couple de propriétaires terriens, Daniel Bandeira réussit un deuxième long-métrage puissant et déterminé. Il débute par une double introduction trompeuse, qui induira deux fausses pistes, elle présente d’abord une séquence de flashback éprouvante filmée d’un téléphone, observant Teresa (charismatique et emphatique Mali Galli) bientôt traumatisée, avant de laisser place à un générique assez graphique puis reprendre avec le personnage, dans sa réalité privilégiée à Récife où elle vit avec son mari, Roberto. Le prologue nous place ainsi du côté des puissants, et passe par deux esthétiques distinctes jusqu’à un cut brutal, nous amenant à découvrir une autre réalité, celle des ouvriers agricoles employés par Roberto, bientôt sans travail, sans maison et endettés. Bandeira, qui a ponctuellement collaboré avec Kleber Mendonça Filho (auquel il emprunte le chef opérateur Pedro Sotero), pourrait se situer partiellement dans son sillage, de son observation initiale d’une classe aisée de Récife à sa faculté à flirter avec le genre, sans perdre de vue un dessein résolument social. Sa vision de la lutte des classes, dans un paysage où le dialogue a été rompu jusqu’à devenir impossible, laissant sa place à une escalade de violence, a quelque chose de profondément viscéral. Entre des individus qui n’ont plus rien à perdre et une « survivante » réfugiée dans sa voiture blindée (son mari est blessé et séquestré), commence un face-à-face à l’intensité crescendo. Tendu, précis et affûté, Daniel Bandeira laisse planer le doute quant à l’issue de son long-métrage, chacun de ses mouvements pouvant faire basculer dans un sens ou dans l’autre son propos. Il opte pour une conclusion radicale et désespérée, à la fois cohérente et inévitable, maintenant un équilibre ténu quant à son point de vue, n’hésitant pas à faire preuve de nuances, sans pour autant affaiblir ou atténuer la portée de son discours. Sacrée claque.
Late Night with the Devil – Cameron et Collin Cairnes (2024) – Compétition

Late Night with the Devil – Copyright Omelete 2024
Auréolé d’un succès d’estime certain, Late Night with the Devil, troisième long métrage du duo australien Cameron et Colin Cairnes, était pour le moins attendu. Récit d’un show télé qui tourne mal et voit son présentateur vedette confronté à des phénomènes de plus en plus étranges, le film est-il à la hauteur de sa hype ? Sous la forme de mise en abyme d’un reportage télévisé relatant le drame survenu lors d’un enregistrement dans les années 70, le binôme de réalisateurs détourne les codes du found footage. En filigrane, ils tendent à livrer un portrait du monde médiatique dans une Amérique plongée en plein tourments (contestation de la guerre du Vietnam, contrecoup de la tuerie de la famille Manson). Mais là où le bât blesse, c’est qu’ils trahissent rapidement leur propre dispositif en présentant des images de coulisses en noir et blanc explicitant plus que de raison le désir de buzz de leur antihéros. In fine, le long-métrage ressemble à un pastiche superficiellement soigné dont les happenings constants, amusants dans l’instant (tels ces effets spéciaux bricolés renvoyant au Stuart Gordon de la grande époque), traduisent une incapacité à créer l’effroi. Un projet de cinéma comme attraction foraine qui pourrait être défendable s’il n’essayait pas, en outre, de dire quelque chose de son époque, en flirtant avec des mythes complotistes bien connus. S’ils maintiennent un temps un doute quant à l’authenticité de ce qu’ils montrent, les Cairnes tiennent plus des bateleurs pros de la com qu’à de nouveaux auteurs sur qui il faudra compter. Divertissant mais parfaitement vain.
Tank Girl – Rachel Talalay (1995) – Haro sur l’autorité !
Tank Girl – Copyright MGM 2002
En 1995, à l’exception des franchises mastodontes DC (Batman et Superman), les adaptations de comics à Hollywood n’en étaient qu’à leurs balbutiements, tout juste sortait The Crow un an auparavant. Rachel Talalay, réalisatrice de La Fin de Freddy : L’Ultime Cauchemar (sixième opus de la saga), collaboratrice de John Waters, en qualité de productrice d’Hairspray et Cry-Baby, allait s’intéresser à Tank Girl créée par Alan Martin et Jamie Hewlett (qui sera plus tard derrière les visuels de Gorillaz) à la fin des années 80. Conçu avec le soutien des créateurs (qui signent pour l’occasion des planches incrustée au long-métrage) avant de faire les frais de nombreux conflits de production qui auront par la suite raison de son succès et de sa considération, le film mérite a posteriori un petit coup d’œil. Sympathique post-apocalyptique à la fois délicieusement kitsch, gentiment cheap et en même temps cohérent dans son univers (un monde ravagé par la sécheresse où les ressources en eau sont très convoitées), ce vrai-faux Mad Max féminin (ou toutes proportions gardées, Furiosa avant l’heure) a quelques atouts à mettre son crédit. On aime, entre autres, ses personnages hauts en couleurs, sa relative liberté de ton et l’abattage de ses actrices. Lori Petty, vue auparavant dans Point Break et Une Equipe hors du commun, méritait assurément mieux que sa carrière éphémère, ici cool, bad-ass et charismatique, elle porte le film avec un plaisir contagieux. En dépit de temps morts dans le récit, Tank Girl est une réussite mineure gentiment punk et totalement pop, qui assure un divertissement inconséquent et réjouissant, à reconsidérer à l’heure d’une overdose de productions désincarnées dans le registre.
Démence – Jan Svankmajer (2005) – Jan Švankmajer le souffle de vie
Demence – Copyright La Traverse 2017
Projet maudit de Jan Svankmajer, Démence peut-être perçu comme son magnum opus. Prévu pour se tourner dans les années 70, le film ne verra le jour qu’en 2008. Un temps finalement nécessaire au cinéaste pour laisser mûrir sa fable inspirée de deux nouvelles d’Edgar Allan Poe, entrecoupé de passages en stop-motion dont il a le secret, et mettant en scène un personnage inspiré du marquis de Sade. Le long-métrage questionne la notion de liberté, de tyrannie, de folie, et impose un constat pessimiste, probable écho à l’expérience du metteur en scène sous le régime soviétique. Hermétique mais nécessaire.
The Coffee Table – Caye Casas – Compétition

The Coffee Table – Copyright Alhena Production 2024
A partir d’une première situation simple et absurde, la dispute d’un couple autour de l’achat d’une table basse, puis d’une deuxième, une vis manquante, Caye Casas livre une comédie noire aux accents gores. Il réussit un huis clos où s’entremêlent tension, gêne et douleur, titillant constamment un rire nerveux tout en refusant les facilités (usage intelligent du hors champ, relances narratives « éprouvantes »). The Coffee Table se rapproche à plus d’un titre du cinéma de son compatriote Alex De la Iglesia (dans la veine du Crime Farpait), ce qui n’est pas un mince compliment. Il n’a pas peur de se confronter frontalement à des angoisses contemporaines qui trouvent un écho particulier dans société espagnole (infanticide, détournement de mineur, agression sexuelle) à travers un langage accessible et rentre-dedans. Sciemment provocateur, il agit moins par inconséquence ou immaturité, que par volonté de créer dialogue et débat. Redoutablement efficace, parfaitement rythmé, d’une durée optimale optimisée, ce premier long-métrage solo mérite le coup d’œil et son cinéaste que l’on retienne son nom en prévision de ses prochaines tentatives.
Last House on Dead End Street – Roger Watkins (1973) – Carte Blanche à Robert Morgan
Last House on Dead End Street – Copyright Barrel 2002
À certains égards, Last House on Dead End Street rappelle très lointainement au Blast of Silence (1961) d’Allen Baron. Deux films fauchés en noir et blanc, essayant de contourner leurs limites, où un réalisateur s’improvise pour l’occasion également acteur et dont la réputation underground perdure dans le temps auprès d’une poignée d’initiés. Quand le premier a acquis le respect de Martin Scorsese, le second (ancien élève d’Otto Preminger) attire à lui les cinéphiles plus déviants et pour cause. Quand l’un fut restauré et est ponctuellement sorti de l’anonymat, l’autre survit dans des copies crades, accentuant sa saleté et sa nature délibérément bisseuse mais aussi sa proximité avec son sujet (crapoteux), le snuff movie. Pourquoi ce film d’exploitation a survécu aux années plutôt qu’un autre ? Quelques idées inspirées de ça et là ? Quelques images impactantes ? Un sensationnalisme opportuniste (le film fut pensé suite à la lecture de la biographie de Charles Manson par Ed Sanders) qui dit quelque chose de son époque ? Les rumeurs de véritables meurtres à l’écran ? Ces questions restent partiellement sans réponse en fin de visionnage, passé la curiosité malsaine d’avoir pu découvrir la chose sur grand-écran. L’aura mystérieuse de Last House on Dead End Street (ou anciennement The Cuckoo Clocks of Hell puis The Fun House) est plus fascinante que le métrage en lui-même. Du même Roger Watkins, on préférera largement son excellent porno, réalisé en 1983 sous le pseudonyme de Gustav Mahler, Corruption.
Stopmotion – Robert Morgan – Séance de clôture

Stopmotion – Copyright Bluelight 2023
Pour son passage au long-métrage après une vingtaine d’années de courts, Robert Morgan signe un film à la fois étonnant, cohérent et surtout réussi. Spécialisé dans l’animation en stop motion qu’il expérimente à des fins horrifiques au point d’avoir développé une signature visuelle bien à lui, le réalisateur a la très bonne idée d’inclure cette particularité au cœur de son script. Son héroïne Ella, travaille dans le domaine de l’animation image par image et a pour mère, une star de la discipline, la condamnant à officier dans son ombre. Logiquement nommé Stopmotion, le film navigue entre l’animation, le thriller psychologique et le body horror, emprunte une trajectoire narrative balisée (il n’a pas peur d’investir des archétypes), qui permet d’attester d’une vraie maîtrise et d’un contrôle avéré d’un récit amené à déraper. Surtout, cette volonté de rester scénaristiquement dans les clous, s’accompagne d’un désir d’en sortir sur la forme, de dériver. Morgan réussit une œuvre troublante, à la fois mentale et viscérale où la matière, qu’elle soit humaine ou animée, est (violemment) éprouvée au fil des images. Il façonne ainsi des visions et des personnages aussi dérangeants qu’obsédants, dans les affres de la création. L’exercice se transforme progressivement en une mise en abyme intimiste et cauchemardesque. Pour le rôle de son alter ego, il peut compter sur l’excellente Aisling Franciosi, déjà formidable dans The Nightingale.
© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.
Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).