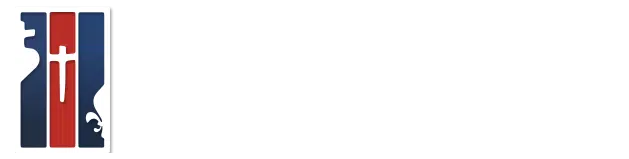Thibaud Guespereau, Henri Vallançon, Thibaud Collin – Artège, 340 pages, avril 2024 – 20€
« Nous ne sommes pas des distributeurs de sacrements ! » La formule est bien connue et renvoie à un des nombreux errements du clergé postconciliaire. Sans adopter cette formule réductrice, de nombreux pasteurs apparaissent néanmoins désabusés, voire découragés, par le peu de fruits observables dans leur vie paroissiale de la réception des sacrements par trop de leurs ouailles. Citons ce jeune baptisé qui ne vient pas à la messe dominicale dès la semaine qui suit son baptême ou ces jeunes mariés qui se séparent un an plus tard. Sans oublier le fait que tous les assistants de toutes les messes communient toujours et se confessent peu ou jamais. Partant de ce constat sévère les auteurs, prêtres, philosophes, sociologues, rassemblés dans cet ouvrage collectif de douze contributions nous proposent des réflexions orientées suivant trois axes :
1 – Le donné de la foi. Rappels catéchétiques sur la grâce, le péché, les sacrements, etc.
2 – Analyse d’une mutation pastorale. Relectures historiques. Ou comment l’abandon de la prédication sur les fins dernières et la croyance dans le salut effectif de tous ont rendu inutile l’usage des sacrements.
3 – Refonder la pastorale dans la doctrine. Quelques exemples d’une pastorale exigeante, ne niant pas la miséricorde, mais permettant au contraire de plus nombreux et durables fruits de conversion.
Ce travail, très complet, permet de nombreux et utiles rappels catéchétiques : un sacrement n’est ni un rite magique ni une cérémonie d’initiation à l’entrée dans une communauté. Il est d’abord et avant tout le signe sensible, et efficace, d’une grâce invisible, dont les fruits dépendent, aussi, des dispositions de celui qui le reçoit. Émergent ainsi les difficultés posées par la distribution des sacrements à des personnes pour qui ils sont surtout des rites sociaux ou des occasions de faire la fête, loin de la perception de la portée réelle des engagements pris ou des caractères imprimés. Plusieurs contributions apparaissent particulièrement pertinentes. Celle de Guillaume Cuchet sur l’abandon de la prédication des fins dernières à partir des années 1960. Celle de Mgr Kruijen sur l’altération de la notion de péché mortel chez les théologiens Karl Rahner et Hans Urs von Balthasar. Les rappels sur la nécessité de la foi, et donc du baptême, pour être sauvé sont tout à fait opportuns ainsi que la définition du péché mortel (matière grave, pleine advertance – ou connaissance de la gravité de ce fait, – plein consentement). On regrettera qu’une intervention n’ait pas traité de la loi naturelle et de son inscription dans le cœur de tout homme, loi dont les préceptes premiers ne peuvent être ignorés invinciblement par un adulte jouissant de la raison. La confusion des esprits est aujourd’hui telle que l’on pourrait soutenir que plus personne ne pèche mortellement, n’ayant finalement jamais l' »advertance » d’enfreindre quelque règle grave que ce soit. « Le salut ne connaît plus alors d’autre limite que la faute subjective grave, autrement dit, ne requiert « que » la fidélité obéissante à la conscience », comme le soutient Karl Rahner dans sa fameuse théorie du chrétien anonyme ou implicite. Ceci en contradiction avec tout l’enseignement traditionnel de l’Église et celui de l’Écriture sainte. Le djihadiste qui suit sa conscience et se fait exploser au milieu d’une foule de mécréants – hommes, femmes et enfants – est certain, selon lui, d’aller au ciel mais est-ce la réalité ? On peut en douter.
D’autres questions plus usuelles auraient pu être abordées. Un prêtre peut-il refuser de célébrer un mariage dont il est certain qu’il ne tiendra pas ? Que signifie le report de l’âge de la confirmation, en France, de 7/8 ans vers 12/18 ans ?
Ce livre constitue un nouveau pas, salutaire, dans la redécouverte de la réalité de ce que sont les sacrements. Démarche heureusement illustrée par le témoignage du curé d’une paroisse du diocèse de Fréjus-Toulon, vers le rétablissement d’un catholicisme plus authentique car plus exigeant avec, à la clé, ce conseil aux pasteurs : « À mon sens il ne faudrait donner aucun sacrement à qui ne veut pas se confesser, et ne donner l’absolution qu’au terme d’un véritable cheminement où la personne parvient à la découverte de ses fautes et au repentir. »
__________________________________________________
Jean-Pierre Maugendre