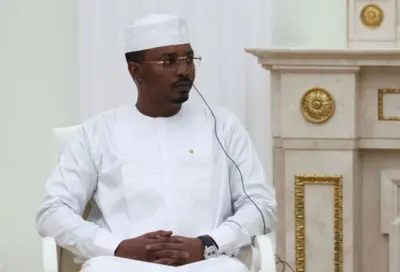Que sait-on de l’alliance de sécurité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ?

Crédit photo, Getty Images
- Author, Isidore Kouwonou
- Role, BBC Afrique
Le Mali, le Niger et le Burkina Faso viennent de faire un pas de plus dans leur désir de rapprochement. Ils ont annoncé le mercredi 6 mars 2024 la création d’une force militaire conjointe pour lutter contre l'insécurité à laquelle sont confrontés les trois pays depuis plusieurs années. C’était lors d’une réunion à Niamey.
Selon le Général Moussa Salaou Barmou, chef d’Etat-major nigérien des armées, la force conjointe des trois pays qui composent l’Alliance des Etats du Sahel (AES) « sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires » de cet espace.
Les trois pays dirigés par des militaires à la suite des coups d’Etat, entendent, par cette force conjointe « créer des conditions d’une sécurité partagée », selon le communiqué qui a sanctionné la réunion à laquelle ont aussi participé les chefs d’Etat-major du Mali et du Burkina Faso.
Il est indiqué aussi qu’un concept opérationnel sera élaboré pour permettre « d'atteindre les objectifs en matière de défense et de sécurité » au niveau des pays de l’AES.
Les défis sécuritaires, le Mali, le Niger et le Burkina Faso n’en manquent pas. Ils sont confrontés à des attaques armées répétitives sur leur sol.
Situation sécuritaire dans l’AES : état des lieux

Crédit photo, Getty Images
En choisissant de se regrouper dans l’Alliance des Etats du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso avaient accepté le 16 septembre 2023 de conclure un pacte de défense mutuelle. C’était dans un contexte où la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) menaçait d’intervenir militairement au Niger lorsque la junte qui a fait le coup d’Etat en juillet a refusé de rétablir l’ordre constitutionnel.
Parallèlement, la situation sécuritaire des trois Etats reste alarmante.
Le 25 février dernier, trois villages et une église ont été attaqués au nord du Burkina Faso. Le même jour, une mosquée a subi également une attaque. Le bilan était d’une dizaine de morts, selon les sources sécuritaires locales.
Des attaques similaires interviennent aussi dans les autres pays de l’AES. En octobre dernier, le Niger a perdu 29 de ses soldats dans une attaque près de la frontière avec le Mali.
En septembre 2023, un deuil de trois jours a été décrété au Mali à la suite de deux attaques distinctes qui ont fait 64 morts dont 49 civils et 15 soldats au nord du pays.
Les trois pays ont subi plusieurs autres attaques qui endeuillent des familles presque fréquemment.
Selon le rapport 2023 de l’Institut pour l’économie et la paix, 310 attaques ont occasionné 1 135 morts et 496 blessés au Burkina Faso en 2022. Au Mali, le rapport attribue 944 morts aux attaques armées. Selon le rapport, les attaques dans ces deux pays ont augmenté de 48% par rapport à l’année précédente (2021).
« L’augmentation du nombre d’opérations terroristes dans la région du Sahel a été significative, (plus de 2 000 % au cours des 15 dernières années). Cela est dû à la situation politique instable, où six tentatives de coup d’État qui ont eu lieu, dont quatre ont réussi », indique le document.
La situation sécuritaire dans la zone est encore préoccupante selon ces rapports. Mais la création d'une force commune arrivera-t-elle à bout de l'insécurité pour les trois pays de l'AES ?
Promesses non tenues par les militaires au pouvoir ?

Crédit photo, Getty Images
Des observateurs pensent qu’il est trop tôt de le dire, mais le désir des populations de ces trois pays de mener une vie calme et paisible devient de plus en plus fort. L’insécurité est devenue le partage quotidien de ces hommes et femmes obligés de quitter leurs lieux d’habitation.
La violence, comme on peut le voir, s’est aggravée ces dernières années dans le Sahel en Afrique de l’Ouest. Les militaires à la tête du Mali, du Niger et du Burkina Faso avaient promis de régler le problème de l'insécurité et sauvegarder l'intégrité de leur territoire lorsqu’ils sont arrivés au pouvoir.
L’ancienne puissance coloniale, la France, présente dans le Sahel depuis des années avec sa force militaire, a été priée de quitter cette zone.
Il en est de même pour la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali (MINUSMA) qui a reçu l’ordre des dirigeants de la junte de quitter le pays où elle est présente depuis une dizaine d’années. Un départ qui a été effectif en décembre dernier.
Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont rapprochés alors de la Russie pour les aider à maintenir la stabilité dans la zone.
Selon Oumar Ba, analyste sécurité Afrique de l’Ouest au Centre d’études stratégiques de Paris, il y a une amélioration avec des gains territoriaux par « les forces de défense des pays de l’AES sur les groupuscules jihadistes et sécessionnistes dans une certaine mesure ».
« Mais on est loin de l’effectivité totale d’une sécurisation optimale, intégrale sur l’ensemble des territoires de ces différents pays membres de l’AES », ajoute-t-il, indiquant que la menace est réelle, diffuse, substantielle et bien perçue par les autorités gouvernantes militaires qui « savent que ce combat est de longue haleine et ne saurait être gagné seul, sans l’assentiment des populations, sans une mobilisation générale patriotique et sans également un soutien de partenaires qui puissent maîtriser la domination du ciel à travers des drones, des satellites ».
Ce sont tous ces facteurs qui expliquent, selon lui, la nécessité de mettre ensemble une force pour faire face à la situation.
Puisque selon Mamadou Adje, ancien Conseiller aux situations d'Urgence de l'Etat-major général des armées à la présidence de la République du Sénégal, les jihadistes ne sont plus dans les petites attaques de villages, mais des attaques de grande ampleur des camps et campements militaires.
Les défis de l'alliance sécuritaire
L'alliance annoncée par les autorités militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso fait partie de la charte du Liptako-Gourma qui a créé l’Alliance des Etats du Sahel en septembre 2023.
L’article 6 de la charte prévoit l’architecture nouvelle de sécurité collective et de défense mutuelle contre toute atteinte et menace contre la souveraineté d'un Etat membre.
Ces pays font face à un ennemi diffus, subtil, et souvent caché dans les populations à la lisière des frontières, qui profite de la porosité de celles-ci et entreprend des actes de déstabilisation, déclare l’analyste de sécurité en Afrique de l’Ouest.
« C’est très difficile de combattre le terrorisme. Ce ne sont pas les grands pays qui vont me démentir là-dessus », fait remarquer Oumar Ba.
Il souligne toutefois que la volonté politique et stratégique ne manque pas aux dirigeants militaires des trois pays. « Nous espérons que les prochains mois pourront nous édifier davantage sur l’efficacité opérationnelle relative ou pas de cette nouvelle force conjointe ».
Cette force, poursuit-il, sera jugée sur le terrain et on verra si elle sera capable de diminuer ou non de façon drastique les attaques jihadistes. « Nous verrons si elle pourra stabiliser de façon durable la zone, sécuriser les populations et restaurer l’intégrité et l’autorité des Etats », dit-il.
En dehors de ces aspects, les Etats de l'AES seront aussi confrontés aux défis liés aux ressources financières, selon Mamadou Adje, ancien Conseiller aux situations d'Urgence de l'Etat-major général des armées à la présidence de la République du Sénégal.
« Le défi financier est du fait de l'assèchement des ressources financières traditionnelles avec le retrait de l'ONU, de la France et des pays qui apportaient le soutien financier, notamment avec le G5 Sahel », souligne-t-il.
Ces Etats comptent aujourd'hui sur le soutien russe pour relever ces défis. Mais restent confrontés également au défi logistique. selon M. Adje, le matériel russe est hétéroclite.
« Ce sont des pays qui ont des matériels français, des formations françaises... Avec l'appui des Russes, le problème de l'opérabilité va se poser ».
Le Sahel, espoir d’une possible stabilisation avec les militaires ?

Crédit photo, Getty Images
Pour le moment, la situation sécuritaire est encore très précaire dans les Etats de l’AES dont certaines parties des territoires sont contrôlées par ces groupes armés.
Selon M. Ba, la stabilisation de la zone est possible. Mais elle ne peut l’être de façon durable que lorsque ces régimes vont corriger leur déficit démocratique.
« Ce sont des régimes civilo-militaires. Leur légitimité démocratique souffre quand même d’un certain manque d’onction légitimatrice qui provient d’élections libres, démocratiques, sincères, transparentes et inclusives », souligne-t-il.
Et donc le retour à l’ordre constitutionnel à travers des scrutins transparents qui répondent aux critères et standards africains et internationaux est une des clés d’une stabilisation durable et de crédibilisation de ces régimes, selon lui.
Les défis économiques, la pauvreté, les inégalités sociales, la précarité, la sécheresse et le terrorisme sont autant de défis que cette stabilité doit relever pour s’insérer dans les forces vives nationales qui épousent la vision prioritaire de stabilisation.
Le Sahel fait plus de 2 780 000 Km2, comprenant des pays gigantesques aux territoires vastes avec des zones de porosité des frontières.
« Il faudra que l’AES puisse trouver un « gentleman's agrement » salvateur avec la CEDEAO pour pouvoir négocier sa sortie et pouvoir trouver des arrangements qui soient gagnant-gagnant pour nos différentes institutions et composantes étatiques », insiste Oumar Ba.
Il prévient que si le Sahel ne le fait pas, il court le risque d’une déstabilisation encore plus lourde avec la poussée djihadiste et des tentatives de coups d’Etat en pleines périodes de transition.
« Je pense que la stabilisation durable de l’espace du Sahel ne saurait réussir de façon fondamentale si l’Afrique est dans une logique de défiance mutuelle entre ces différents Etats et ces différentes organisations et si les populations n’ont pas droit au chapitre pour choisir leur destin de façon libre, démocratique et transparente », précise-t-il.