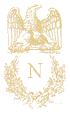

Michel Ney, duc d’Elchingen, prince de la Moskowa, maréchal d’Empire, né le 10 janvier 1769 à Sarrelouis en Lorraine, (département de la Moselle en 1790 aujourd’hui en Allemagne, Land de la Sarre) et mort le 7 décembre 1815 à Paris, place de l’Observatoire.Le maréchal Ney était surnommé par Napoléon Ier le brave des braves.
Sous l’Ancien Régime
D’origine modeste, son père étant ouvrier tonnelier mais qui avait été soldat et avait participé à la guerre de Sept Ans, Michel recevra une formation première insuffisante. Il abandonna un travail de bureau pour entrer au service à l’âge de 19 ans, comme hussard, dans le 5e régiment de Colonel-Général à Metz, en 1787, contre l’avis de son père. Après être passé par tous les grades inférieurs, il devint sous-officier à la Révolution française.
Son aptitude, sa bonne conduite, son allure militaire, ne tardèrent pas à lui procurer la bienveillance de ses chefs. Il obtint promptement le grade de sous-officier, qu’un roturier ne franchissait guère dans ce temps-là. C’est au moment de cette promotion qu’il eut, avec un nommé Malasson, du régiment des chasseurs de Vintimille, un duel dont les conséquences lui fournirent dans la suite l’occasion d’une bonne action.
Malasson était un spadassin dangereux, toujours le sabre à la main, redoutable aux jeunes recrues et même à d’habiles tireurs. Il avait blessé le maître d’armes du Colonel-Général-Hussard et insulté le régiment. Les sous-officiers se réunirent pour punir l’insolent. Comme le .plus brave et le plus adroit,Ney, fait brigadier depuis peu, est chargé de la vengeance de ses camarades. On se rend sur le terrain. Les sabres sont croisés.
Tout-à-coup Ney se sent violemment tirer par derrière : c’est son colonel qui le fait arrêter et jeter dans un cachot.
Le duel, était « alors puni de mort. Heureusement l’affection de ses camarades et de ses chefs tira Ney de ce mauvais pas. Les sous-officiers allèrent en masse demander sa grâce chez le colonel. Ney en fut quitte pour une assez longue captivité qui le sauva du conseil de guerre. A peine sorti de prison, il n’hésite pas, malgré le double danger qu’il va encore courir, à rester le champion d’une querelle qu’il croit ne pouvoir vider honorablement que par les armes. Un nouveau combat a lieu plus secrètement. Ney est vainqueur. Un coup de sabre sur le poignet estropie pour jamais son adversaire qui, réformé par suite de celte blessure, tomba bientôt dans la misère. Le brigadier, devenu riche, n’oublia pas son duel; il chercha.le malheureux Malasson, parvint à le’découvrir, et lui fit une pension.
Guerres de la Révolution
Le général Kléber le fit nommer lieutenant de l’armée du Rhin en 1792, capitaine en 1794, puis chef d’escadron et adjudant-général. C’est un des premiers généraux à repérer ses talents.Ses hommes lui ont déjà donné un surnom : «l’Infatigable». Comme il est rouquin, ses hommes l’appellent également le « rougeaud »; il n’est pas facile, orgueilleux, susceptible mais n’a peur de rien.
Général de brigade sur le champ de bataille en 1796, il venait de prendre Wurtzbourg avec 100 hommes de cavalerie seulement, et avait forcé le passage de la Rednitz et pris Forcheim, 70 pièces de canon et d’immenses approvisionnements. En 1797, il contribue à la tête de ses hussards aux victoires de Neuwied et de Dierdoff. En 1798, Ney réédite son exploit et s’empare de Mannheim par la ruse, avec seulement cent cinquante hommes. Il est promu général de division. Général de division en l’an IV, il signe avec les symboles maçonniques, car, comme beaucoup de militaires, il est maçon.
En septembre 1799, il commanda provisoirement l’armée du Rhin. Ney fit faire, à la fin de septembre 1799, entre Seltz et Mayence, quelques attaques qui réussirent complètement. On s’empara de Francfort, Hochstedt fut enlevé de vive force, la Nidda fut passée. Le coup d’État du 18 brumaire n’eut pas son soutien total. Il épousa Aglaé Auguié, amie d’Hortense de Beauharnais depuis leur séjour à la pension de Mme Campan. Le mariage a lieu à Grignon avec Savary comme témoin. Puis, Kléber parti avec les troupes de la campagne d’Égypte, le futur maréchal Ney servit sous les ordres du non moins prestigieux général Moreau. Tous deux, ainsi que Richepance, mirent fin aux guerres de la Révolution, en remportant la bataille de Hohenlinden, le 3 décembre 1800.
Premier Empire
Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de la République helvétique en 1802, il sut imposer le gouvernement unitaire voulu par le Premier Consul et pacifier ce pays menacé de la guerre civile, ce qui lui valut l’estime de Talleyrand. Il y fera également la connaissance d’un historien curieux de stratégie, Jomini, qui va l’impressionner et aura sur lui une influence souvent douteuse. Nommé commandant de l’armée de Compiègne en 1803, il commande le 6e corps à Montreuil-sur-Mer, au camp de Boulogne, creuset de ce qui sera la Grande Armée. Le 8 mai 1804, c’est l’Empire, et 18 maréchaux sont nommés; Ney figure au 12e rang. Par la suite, il est nommé grand aigle le 1er février 1805.Le 14 octobre 1805, il gagne la bataille d’Elchingen, décisive pour la reddition de la forteresse d’Ulm, le 21 octobre 1805. Il reçoit le titre de duc d’Elchingen le 6 juin 1808, en souvenir de ce fait d’armes.
La capitulation d’Ulm ne fut que le prélude d’Austerlitz. Pendant que Napoléon Ier frappait ce grand coup, Ney, détaché vers le Tyrol avec la droite de la grande armée, terminait la campagne en chassant du Tyrol l’archiduc Jean, en s’emparant d’Innsbruck et de la Carinthie. Bientôt s’ouvrit la campagne de Prusse. Présent à Iéna, le 14 octobre, il emmène ses divisions à l’assaut des lignes prussiennes. Mais, emporté par son élan, il se retrouve encerclé. Lannes le tire de ce mauvais pas. Le lendemain, il prend Erfurt et quelques jours plus tard entame le siège de Magdebourg, siège qui dure moins de 24 heures. La bataille d’Eylau (8 février 1807), si elle n’est pas perdue grâce aux charges du maréchal Murat, est gagnée grâce à l’arrivée propice et inespérée du 6e corps commandé par le Maréchal Ney. Avec seulement 14 000 soldats, il contraint les 70 000 soldats russes à se replier, à Guttstadt. Le 6e corps, était chargé de poursuivre le Prussien L’Estocq au nord. Mais le contact avec L’Estocq n’étant pas établi, Ney décida en entendant le bruit de canon de rejoindre le combat, parcourant 80 kilomètres en une seule journée.
La victoire de Friedland peut aussi être mise en partie à son crédit. En Espagne, sous les ordres de Masséna, il est moins heureux à cause de son caractère jaloux et ses disputes avec Jomini, son chef d’état-major, et surtout la haine réciproque qu’il entretenait avec le maréchal Soult. Fait unique pour un maréchal, il fut démis de son commandement et rejoignit Paris où Napoléon ne lui fit aucun reproche. Mais l’image d’Épinal, représente à tout jamais le maréchal Ney lors de son héroïque campagne de Russie en 1812. Il y dirigeait le 3e corps d’armée. Pendant la phase offensive de la campagne, il occupait le centre du front de l’armée, et participa à des combats sanglants et frontaux tels que Smolensk ou Moskowa, le 6 septembre 1812 où il reçut une balle dans le cou. Ce dernier combat lui valut le titre de prince de la Moskowa. Puis pendant la retraite, il se dévoua à l’arrière-garde de l’armée.
Pendant 40 jours, il protégea les débris de l’armée donnant le plus de temps possible aux civils et aux blessés pour suivre la retraite. Laissé à l’extrême arrière-garde après la bataille de Krasnoïe, surnommée par les Russes la bataille des héros, il n’avait que 6 000 hommes et se vit attaquer par des forces supérieures qui lui fermaient la marche ; il se retire devant elles, surprend le passage du Dniepr, passe malgré le harcèlement des Cosaques et rejoint, après trois jours et par d’audacieuses manœuvres, Napoléon, qui disait hautement qu’il donnerait 300 millions pour sauver le Brave des braves. Lors de la bataille de la Bérézina, il remporte une magnifique victoire. En faisant charger des cuirassiers sur des tireurs embusqués dans une forêt, il réussit l’exploit de faire 5 000 prisonniers avec seulement 7 000 hommes. Il sauve les débris de l’armée, et sort de Russie après des marches forcées et en affrontant encore de nombreux dangers.
Restauration
À Fontainebleau, il incita fortement l’Empereur à abdiquer et se rallia aux Bourbons, ce qui lui valut d’être nommé pair de France par Louis XVIII. Il fut le premier des maréchaux qui abandonna Napoléon après la capitulation de Paris. La Restauration fut une période contrastée pour le maréchal Ney comme tous les autres « parvenus » de la Révolution française. La France le comblait d’honneurs (Commandant en chef de la cavalerie de France, gouverneur de la 6e division militaire), mais les milieux aristocrates et les anciens émigrés raillèrent cette nouvelle noblesse fabriquée par l' »usurpateur ».
Les Cent-jours
Lors du débarquement de Napoléon à Golfe-Juan le 1er mars 1815, il proposa au roi Louis XVIII de ramener Napoléon « dans une cage de fer » mais au contraire se rallia à l’Empereur. Contrairement à de nombreuses idées reçues, il n’y eut pas d’affrontement entre les troupes du maréchal Ney et de Napoléon. La fameuse rencontre d’Auxerre entre le maréchal Ney et Napoléon, fut en fait une rencontre à huis clos. Les témoignages divergent. Il semble que les deux hommes aient fortement haussé le ton. Certains prétendent que Napoléon aurait fortement tancé son maréchal pour sa « défection » de 1814. Le maréchal Ney a soutenu pendant son procès avoir exigé de Napoléon : Qu’il ne joue plus au tyran. En tout cas, les deux personnages emblématiques semblèrent fâchés et ne se revirent plus jusqu’au 12 juin 1815, quand Napoléon rappela le maréchal Ney pour commander les 1er et 2e corps d’armée dans la campagne de Belgique qui commençait.
Waterloo et la campagne de Belgique
le Maréchal Ney, appelé de dernière minute, n’arriva aux Quatre-bras que le 15 juin 1815, seul, sans état-major, et transporté dans une charrette de paysan. Dès le lendemain commença la bataille des Quatre-Bras où un faible détachement de Britanniques et Hollandais résista malgré un manque de munitions. Pour le Mullié, le maréchal Ney prétendit n’avoir pas reçu d’ordre précis d’attaque, et Napoléon dit avoir envoyé un courrier précis exigeant cette attaque. Rétrospectivement on peut dire que cet ordre est un mensonge de Napoléon. Le maréchal Soult, chef d’état-major durant cette campagne et ennemi personnel du maréchal Ney, avoua sur son lit de mort au fils de Ney n’avoir jamais eu connaissance de cet ordre. Or, tous les ordres passaient normalement entre ses mains. Cette bataille manquée est probablement, à ce jour, un des seuls reproches qu’on puisse faire au maréchal Ney.
S’ensuit la bataille de Waterloo. Napoléon est très malade ce jour-là. Il fut surpris plusieurs fois vomissant et somnolant loin du champ de bataille. Le maréchal Ney quant à lui fit preuve à son habitude d’une activité débordante. On dit qu’ils avaient les vêtements lacérés, le visage souillé de boue et de sang, et le chapeau perdu. Pour le Mullié, tout se résume à un moment bien précis. Vers 15 h 30, la 1re ligne britannique amorce un recul stratégique derrière le chemin d’Ohain au fort dénivelé. Le maréchal Ney croit alors à une retraite britannique, et lance toute sa cavalerie à la charge. Et ce avec d’autant plus d’empressement que l’on sait déjà que les Prussiens s’approchent. La charge est énorme. Une des plus grosses charges de cavalerie de l’histoire. Napoléon déplore cette charge, mais la soutient néanmoins avec la cavalerie sous ses ordres. La cavalerie est trop nombreuse, d’autant plus que des bataillons suivent spontanément ce mouvement d’ampleur. Mais malgré cela la charge réussit. Wellington donne des ordres pour préparer un embarquement. La ferme de la Haie Sainte passe aux Français.
Le maréchal Ney fait demander un renfort d’infanterie à Napoléon qui refuse, alors qu’il disposait alors du corps de Mouton-Duvernet. En quelques instants la bataille bascule, les carrés britanniques se reforment, et peu après, la cavalerie prussienne arrive au contact. Le maréchal Ney repart à l’attaque, à pied, à la tête de l’infanterie restante, à la tête de la division Durutte, en s’écriant : Venez voir comment meurt un maréchal de France ! Mais sans réussite. Son sublime entêtement, échoua, accentuant d’autant plus les pertes françaises. Il eut ce jour-là cinq chevaux tués sous lui. Tous les témoins dirent qu’il cherchait la mort, mais que la mort ne voulut pas de lui. Après la défaite, vint le temps des règlements de comptes. Napoléon dès son retour à l’Élysée culpabilisa ses maréchaux et notamment le maréchal Ney, et le maréchal de Grouchy. Le maréchal Davout prit la défense du maréchal Ney en disant : Sire, il s’est mis la corde au cou pour vous servir !
L’arrestation
À la seconde Restauration, le maréchal Ney est détesté par tous les partis, sauf par les Républicains qui étaient alors trop minoritaires. Il est décidé que ceux qui s’étaient mis au service de l’Empereur avant le 20 mars 1815, date à laquelle Louis XVIII avait quitté la capitale, étaient des traîtres. Fouché établit la liste, avec un seul maréchal sur cette liste (ordonnance du 24 juillet 1815) et tout en haut : le maréchal Ney. Selon d’autres, Fouché, alors ministre de la Police, lui donna deux passeports pour fuir en Suisse ou aux États-Unis. Cependant, le maréchal Ney, resta en France, chez une cousine de sa femme. Il est alors arrêté au château de la Bessonie, près d’Aurillac. Le maréchal arrive à Paris sous escorte le 19 août. Il est aussitôt incarcéré à la Conciergerie. Il est transféré à la prison du Luxembourg en traversant des villes où l’on souhaite soit le lyncher, soit le délivrer. En chemin, le général Exelmans, lui proposa de le délivrer et de l’escorter où il le souhaite, mais il refusa. On dit que des officiers vinrent le libérer à la prison du Luxembourg, mais qu’il refusa aussi.
Le procès
Le conseil de la Guerre devait juger le maréchal Ney. Mais il devait comprendre des maréchaux de France et la présidence en revenait de droit à leur doyen, le maréchal Moncey, duc de Conegliano. Celui-ci se récusa dans une lettre adressée au roi. Mécontent, le roi destitua Moncey et lui infligea trois mois de prison. Le maréchal Jourdan fut alors désigné pour présider le Conseil de guerre. Ney est assisté par Berryer père et André Dupin. Le maréchal Ney ne souhaite pas être jugé par ses anciens camarades dont il craint la rancune à la suite d’incidents passés. Ney a été élevé à la pairie par Louis XVIII ; il peut donc exiger d’être jugé par la Chambre des pairs, pourtant majoritairement composée de royalistes convaincus.
Ainsi, devant le parterre de maréchaux et de généraux qui composent le conseil de guerre, l’accusé dédaigne-t-il de répondre à l’interrogatoire d’identité et déclare, à la stupéfaction générale, récuser la compétence du tribunal. Pair de France au moment où se sont déroulés les faits dont il est accusé, il demande, en se fondant sur les articles 33 et 34 de la Charte, son renvoi devant la Chambre des pairs. Le conseil se retire et par 5 voix contre 2 se prononce pour l’incompétence, le 10 novembre, et Ney fut jugé par la Chambre des pairs. C’est donc la Chambre de Pairs qui juge le maréchal Ney. Plusieurs éminents personnages se font dispenser, dont Talleyrand, qui dit ne vouloir participer à un tel crime. Le débat est à sens unique, la Chambre des pairs étant à forte majorité monarchiste. La défense aborde peu la discussion des faits, et fait porter son effort sur un moyen de droit.
Le maréchal Davout avait signé avec les Alliés le 3 juillet une convention dont l’article 12 spécifiait qu’aucune poursuite ne pourrait être exercée contre les officiers et soldats pour leur conduite pendant les Cent-Jours. Condamner le maréchal Ney revenait à violer cette convention. La Chambre des pairs décida d’interdire à la défense de développer ce moyen, car «il aurait dû être plaidé avant tout débat sur le fond». Un ultime rebondissement survient le 6 décembre. La ville de naissance de Ney, Sarrelouis, vient de devenir prussienne depuis le traité de Paris du 20 novembre. Dupin déclare donc que Ney ne peut être jugé, car il est maintenant prussien. Évidemment, le maréchal Ney, se lève, interrompt son avocat, et dit : « Je suis français et je resterai français ! ». Trois questions de fait sont donc d’abord posées : « le maréchal Ney a-t-il reçu des émissaires dans la nuit du 13 au 14 mars ? » : l’appel nominal donne les résultats suivants : 111 voix pour, 47 contre.
Le comte Lanjuinais, le marquis d’Aligre et le comte de Nicolaï s’abstinrent, protestant qu’ils ne pouvaient juger en conscience, attendu qu’on avait refusé à l’accusé le droit de se faire entendre sur la convention de Paris ; « le maréchal Ney a-t-il lu, le 14 mars, une proclamation invitant les troupes à la défection ? » : trois pairs, ceux qui venaient de protester, votent contre, et 158 votent pour ; 3. « le maréchal Ney a-t-il commis un attentat contre la sûreté de l’État ? » : le vote donne 157 voix pour, 3 voix pour avec atténuation et 1 voix contre. Lanjuinais a répondu « oui » mais en ajoutant « couvert par la capitulation de Paris » ; d’Aligre et de Richebourg « oui » mais en faisant appel à la générosité de la Chambre. Le vote négatif est celui du duc de Broglie, le plus jeune des pairs de France qui déclare : « Je ne vois dans les faits justement reprochés au maréchal Ney ni préméditation ni dessein de trahir. Il est parti très sincèrement résolu de rester fidèle. Il a persisté jusqu’au dernier moment. »
La dernière question porte sur la peine à appliquer. Lanjuinais, soutenu par Malville, Lemercier, Lenoir-Laroche et Cholet, tente de faire adopter la peine de déportation que 17 pairs votèrent. Parmi eux, le duc de Broglie. Cinq pairs, le comte de Nicolaï, le marquis d’Aligre, le comte de Brigode, le comte de Sainte-Suzanne et le duc de Choiseul-Stainville, tout en s’abstenant, proposent de recommander le maréchal à la clémence du roi. Finalement, 139 voix, réduites à 128, à cause d’avis semblables entre parents, réclament la peine de mort. Parmi ceux qui ont voté la mort : 5 maréchaux d’Empire : Sérurier, Kellermann, Pérignon, Victor et Marmont (au contraire, le maréchal Davout est venu le défendre, et le maréchal Laurent de Gouvion Saint-Cyr a voté la déportation), le vicomte de Chateaubriand, le comte Ferrand surnommé « le Marat blanc » et le comte Lynch nommé par Napoléon maire de Bordeaux, comte de l’Empire et chevalier de la Légion d’honneur, qui va jusqu’à réclamer la guillotine.
En outre, non content d’avoir obtenu la condamnation du maréchal, Bellart requiert qu’il soit rayé des cadres de la Légion d’honneur. Une petite phrase circule sur l’avocat Bellart à l’époque : « Si l’éloquence est un bel art, Bellart n’est point l’éloquence. » La sentence est rendue à onze heures et demie du soir. Les pairs appliquent la règle du conseil de guerre et la lisent en l’absence de l’accusé. Les défenseurs ayant compris que tout espoir est perdu n’assistent pas à la lecture de l’arrêt et se rendent dans la cellule qu’occupe depuis deux jours le maréchal, au Palais du Luxembourg. C’est une petite pièce située au troisième étage sous les combles, à l’extrémité ouest de la galerie où le Sénat conservateur avait installé ses archives, au-dessus de l’actuelle salle des conférences. Une plaque de marbre y a été apposée en 1935.
L’exécution
Pendant la lecture de la sentence, les défenseurs du maréchal vont le voir dans sa cellule. Après leur départ, il se met à rédiger ses dernières dispositions et dort tout habillé. À 3 heures du matin, le secrétaire-archiviste de la Chambre des pairs, Cauchy, le réveille pour lui communiquer la sentence. Le général de Rochechouart, qui commande la place de Paris, l’informe qu’il peut recevoir trois visites : sa femme, son notaire et son confesseur. La maréchale vient rendre visite à son mari dans la cellule avec leurs quatre enfants. Elle s’évanouit en apprenant la sentence. C’est en vain qu’elle implora sa grâce auprès de Louis XVIII. Celui-ci aurait dit qu’il était favorable à cette requête, mais que seuls Wellington ou la duchesse d’Angoulême (fille de Louis XVI), pouvaient en prendre la décision.
La maréchale alla alors, demander grâce à Wellington qui accepta tout d’abord, puis renonça devant les difficultés et les obstacles. Puis, elle alla voir la duchesse d’Angoulême qui refusa sèchement. Cette dernière dit plus tard, après avoir lu les témoignages du comte de Ségur, regretter son geste. Et que s’il elle avait su qui était réellement le maréchal Ney, elle aurait demandé sa grâce. On proposa un confesseur à Ney qui répliqua, « Vous m’ennuyez avec votre prêtraille ! ». Puis il accepta finalement, convaincu par un ancien soldat de la campagne de Russie, devenu croyant à cette occasion. Ney écrit une dernière fois à son beau-frère. Puis il s’entretient avec le curé de Saint-Sulpice.
À 8 h 30 une voiture vient chercher Ney. Il porte un simple costume bourgeois. Le cortège s’arrête avenue de l’Observatoire. Le maréchal refuse qu’on lui bande les yeux et, s’adressant aux soldats : « Camarades, tirez sur moi et visez juste ! ». Rochechouart rapporte qu’il prononça également les paroles suivantes : « Français, je proteste devant Dieu et la patrie contre le jugement qui me condamne. J’en appelle aux hommes, à la postérité, à Dieu. Vive la France ! ». Puis il s’écroule sous les balles. La phrase qu’on lui prête « Soldats, visez droit au cœur ! » semble plus romanesque que véridique. Il tombe face contre terre. Conformément à la coutume, la dépouille resta quinze minutes seule. Un cavalier britannique fit bondir son cheval par-dessus le cadavre. Un officier russe, qui avait exprimé ostensiblement sa joie, fut rayé des listes de l’armée russe par Alexandre Ier qui appréciait beaucoup le maréchal Ney.
L’affaire Peter Stuart Ney
Un homme se réclamant de son identité est mort à Brownsville en Caroline du Nord en 1846. Il s’appelait Peter Stuart Ney. Pierre était le prénom du père du maréchal Ney, et l’on dit que sa mère descendait de la dynastie des Stuart écossais. Ce Peter Stuart Ney enseignait le français, l’allemand, l’hébreu et les mathématiques. Il affirma être le maréchal Ney à deux reprises : tout d’abord, lorsqu’un élève lui apporte un journal français annonçant la mort de Napoléon. Il s’évanouit et est transporté chez lui. Quelques heures plus tard, l’élève vient lui rendre visite, pour prendre de ses nouvelles. Il découvre un Peter Stuart Ney ensanglanté dans son lit, avec les veines tranchées. Peter Stuart Ney survécut.
Et la seconde révélation eut lieu sur son lit de mort. Il dit en anglais : « By all that is holy, I am Marshal Ney of France! ». (Par tout ce qui est saint, je suis le maréchal Ney de France).Plusieurs soldats vinrent identifier ce mystérieux personnage, et furent catégoriques, il s’agissait bien pour eux du maréchal qui les avait menés au combat. Deux expertises graphologiques eurent lieu. Elles donnèrent des résultats contradictoires. La tombe de Peter Stuart Ney arbore un petit drapeau français et l’inscription : « In memory of Peter Stuart Ney, a native of France and soldier of the French Revolution under Napoleon Bonaparte, who departed this life November 15, 1846, aged 77 years. » (En mémoire de Peter Stuart Ney, originaire de France et soldat de la Révolution française, servit Napoléon Bonaparte, il quitta ce monde le 15 novembre 1846, à 77 ans}.
Cette légende est accréditée par le fait qu’en 1903, lorsque la Troisième République française décide de donner au maréchal Ney une sépulture digne, le fossoyeur qui ouvre le cercueil constate et témoigne à qui veut bien l’écouter, que le cercueil est vide. La mauvaise qualité du cercueil en sapin, qui s’effrite facilement, avait fait que le squelette s’était retrouvé recouvert par ces fragments de sapin. Ney était depuis 1815 enterré sous une simple dalle. On construit donc l’actuelle tombe, massive et digne. Pourtant des auteurs ont accrédité cette thèse, par exemple Michel Dansel.Selon lui, son exfiltration a été organisée par la franc-maçonnerie dont il était membre.
Postérité
Plusieurs monuments célèbrent le maréchal Ney : sa tombe officielle au Cimetière du Père-Lachaise, division 29, à l’angle du chemin des Acacias et du chemin Masséna, sa statue pédestre par Charles Pêtre sur l’Esplanade de Metz, chef-lieu de la Moselle où il a commencé sa carrière, à proximité du boulevard qui porte son nom. En 1831 Louis Philippe 1er, réhabilite le maréchal Ney et le réintègre sur les listes de la Légion d’honneur. En 1848, le gouvernement provisoire de la Seconde République française, décide de construire une statue du maréchal Ney à l’emplacement même où il a été fusillé. L’œuvre est confiée au sculpteur François Rude. Cette statue est terminée en 1853, et inaugurée sous Napoléon III. L’Empereur est absent et le discours est très tiède. Cette statue peut se voir actuellement place de l’Observatoire à Paris. Elle a été légèrement déplacée lors de construction du RER B.
