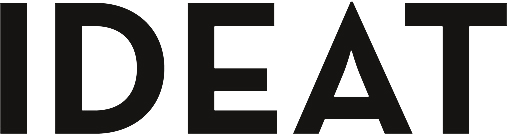À l’instar d’autres figures féminines, Marianne Brandt (1893-1983) a été négligée par l’histoire du design. Si certaines, comme Eileen Gray et Charlotte Perriand, ont vu leurs carrière et histoire honorées à grand renfort d’expositions et de publications, celles de Marianne Brandt, figure majeure du Bauhaus, restent encore matinées de mystères. Des énigmes que Stéphane Dupont, graphiste et chercheuse, tente de percer.
À lire aussi : Les 17 plus grandes designeuses du 20e siècle à connaître absolument
Stéphane Dupont sur les traces de Marianne Brandt
Stéphane Dupont est graphiste depuis une quinzaine d’années. Elle travaille auprès d’institutions culturelles et militantes dans l’univers de l’édition et de l’imprimé. Elle se souvient de sa première rencontre avec le Bauhaus. « Quand j’étais étudiante aux Arts Déco, je suis partie en résidence au Bauhaus de Weimar, je m’intéressais à cette école, à ce mouvement et à son esthétique. Quand on est dans les murs, dans les bâtiments, tout devient plus vivant, l’histoire devient plus compréhensible et plus matérielle« . Mais l’histoire, justement, ne s’arrête pas là.

« Quelques années plus tard, un ami m’a rapporté de Berlin un portrait de Marianne Brandt. Nous étions dans sa bibliothèque, très fournie sur les périodes du modernisme et du Bauhaus. Le portrait dans les mains, je me suis dit : “Bien sûr, je connais Marianne Brandt, je connais son travail, ses objets, mais de sa vie, je ne sais rien.”Je me posais depuis longtemps la question de toutes ces femmes passées par le Bauhaus, dont on connaît les travaux mais dont on sait si peu de choses, continue Stéphane Dupont. Dès que j’ai pu, je suis partie à Berlin avec le portrait, et j’ai commencé à éplucher les archives du Bauhaus, pour mieux comprendre son parcours. Il s’agissait encore de recherches plutôt personnelles, qui ont plus tard abouti à la rédaction d’une monographie, grâce au soutien du CNAP qui m’a attribué une bourse en tant que graphiste. »
Une bourse qui a permis à Stéphane Dupont de dessiner un alphabet « pour lui rendre hommage. J’ai travaillé depuis ses dessins techniques et ses objets, pour en faire des assemblages de formes. C’était la première phase de ce travail. » S’en suit l’exposition « Lettres à Marianne Brandt », qui a eu lieu en octobre 2017 à la galerie My Monkey, à Nancy. Stéphane Dupont ne s’arrête pas là et continue à creuser. Résultat des courses, elle planche actuellement sur une biographie sur la designer, prévue pour 2025 (éditions Xavier Barral).

Marianne Brandt et les femmes du Bauhaus
Mais pourquoi elle ? « Parce que l’on ne savait pas grand-chose de sa vie, insiste Stéphane Dupont. Et il y en a d’autres dont on ne sait rien. Quand on regarde les très nombreuses biographies du Bauhaus, la plupart sont consacrées aux hommes. Tous ont leur monographie attitrée, parfois même plusieurs. Quant aux femmes, elles sont souvent regroupées dans des ouvrages collectifs du type Les femmes du Bauhaus de Susanne Böhmisch. »
Marianne Brandt naît à Chemnitz en 1893. À ses 18 ans, elle part à Weimar pour étudier la peinture. Elle y revient à ses 30 ans pour intégrer l’Institut national des arts appliqués, désormais connu sous le nom de Staatliches Bauhaus. Elle abandonne alors sa carrière de peintre pour explorer le photomontage. “Ses travaux trahissent son don artistique et comme la dadaïste Hannah Höch, elle y exerce son esprit critique vis-à-vis de la vie au Bauhaus, du rapport entre les genres et les questions de société de son époque, mais ses créations n’étaient pas destinées à être exposés, raconte l’historienne. C’est László Moholy-Nagy, responsable du cours préliminaire et maître de l’atelier métal qui avait repéré Marianne Brandt, l’avait acceptée dans son atelier et n’avait cessé de l’encourager à développer son talent. »

« Elle est la seule femme à avoir réussi à s’y imposer, continue Stéphane Dupont. La relation entre Marianne Brandt et László Moholy-Nagy est un véritable patronage, le seul cas que le Bauhaus ait connu. Aucune autre étudiante n’a bénéficié d’un tel soutien, et son importance devient évidente lorsque László Moholy-Nagy quitte le Bauhaus en 1928. Certes, elle lui a succédé, reprenant la tête de l’atelier de métal, à l’essai, mais n’a jamais pu s’imposer et quitta l’école au bout d’un an. Le travail du métal était traditionnellement une pratique masculine et il allait le rester. Avec Gunta Stölz, qui avait acquis de haute lutte la direction de l’atelier textile, Marianne Brandt fut la seule femme à obtenir une telle position. »
S’intéresser à la vie de Marianne Brandt impose de s’interroger sur la place des femmes au sein de la célèbre école d’architecture et d’arts appliqués. “Il y a évidemment une question de genre dans l’histoire du Bauhaus, abordée par des historiennes depuis quelques années maintenant. Au début, Walter Gropius avait affirmé la totale égalité entre femmes et hommes, explique Stéphane Dupont. C’était inscrit dans son programme de 1919, mais on se rend compte qu’il y avait bien une différence de traitement entre les élèves des deux sexes. Si l’école se voulait paritaire à ses débuts, deux ans après sa création, la part des femmes diminue. L’histoire est désormais bien connue. » L’historienne allemande Anja Anja Baumhoff, avec qui la graphiste collabore, rapporte qu’en 1920, le Bauhaus a fondé une classe de filles dans le but de les exclure de certains domaines. « Les femmes ont rapidement été reléguées au tapissage. La trajectoire de Marianne Brandt en est donc d’autant plus singulière. »
Des objets devenus cultes
L’historienne précise qu’elle donne naissance à des classiques du Bauhaus, à l’image de sa célèbre théière MBTK 24 SI conçue en 1924, lors de sa première année au sein de l’atelier de métallurgie. “Elle symbolise la conception même du design tel qu’il était enseigné au Bauhaus, qui incitait les étudiants à travailler les formes et les couleurs fondamentales : on reconnait bien le carré, le cercle et le triangle dans cet objet qui ne mesure que 7,5 cm de haut. Elle est dotée d’une poignée en ébène en forme de demi-cercle et d’un passe-thé amovible. La surface lisse est en laiton et métal argenté. Mais les coûts de production étaient à l’époque trop élevés pour qu’elle puisse être produite en série.” explique Anja Baumhoff. Outre cette icône du Bauhaus éditée par Tecnolumen, la designer a conçu des cendriers, dont certains sont aujourd’hui édités par Alessi.

En 1926, elle conçoit des luminaires pour le bâtiment du Bauhaus à Dessau. Elle travaille également avec le designer Hin Bredendieck pour organiser la coopération de l’école avec d’autres créatifs et maisons d’édition. Elle s’illustre aussi dans la création de lampes, destinées à la production en série, toujours avec Hin Bredendieck. Elle quitte le Bauhaus à la fin de l’année 1929. De juillet à décembre 1929, elle officie dans le cabinet d’architectes de Walter Gropius et participe au développement de l’aménagement intérieur des maisons du lotissement Dammerstock à Karlsruhe. Puis, elle devient directrice du département de design de l’usine métallurgique Ruppelwerk à Gotha, où elle reste jusqu’en 1932.
Une vie ponctuée d’interrogations
Par la suite, “Brandt navigue entre Berlin, Paris et la Norvège (d’où son mari Erik est originaire), mais cela devient terrible avec la montée du nazisme au début des années 30. Jusqu’à l’après-guerre elle traverse une période très éprouvante et économiquement difficile. Elle n’a plus de matériel, plus d’économie, contrainte par l’interdiction à travailler comme designer. Sa maison est bombardée en 1945. Elle a, par conséquent, perdu ses archives. Mais petit à petit, elle se reconstruit et enseigne à Dresde puis à Berlin. Elle poursuit ses travaux, mais la reprise économique en Allemagne est longue. Jamais elle n’a profité, comme Bayer, Breuer et tous les autres partis à Londres, Chicago ou New York, de l’aura du Bauhaus.”

Jusqu’à la fin de sa vie, “elle dessine sans arrêt. Dans les années 80 il y a un regain d’intérêt pour le Bauhaus, on lui demande alors ses croquis, ses archives, ses objets. Un de ses cendriers de 1924 est édité. Ses créations font partie des collections du MoMA depuis l’exposition de 1938, ses photomontages sont rassemblés et édités, ses photographies exposées. En 2019, une exposition rend hommage à son travail pour Ruppelwerk à Gotha.”
On se demande pourquoi Marianne Brandt n’a jamais tenté l’aventure américaine comme les autres acteurs du Bauhaus. « Cela fait partie des questions auxquelles il n’est pas si simple de répondre, affirme Stéphane Dupont. Aussi parce qu’il n’était pas si simple de partir lorsque l’on était une femme seule. Son père était malade au moment où elle aurait eu cette opportunité et peut-être espérait-elle aussi poursuivre sa carrière en Allemagne, là où elle l’avait amorcée, afin de ne pas s’éloigner des siens. Si elle partait aux Etats-Unis, peut-être se serait-elle de nouveau retrouvée sous une certaine autorité de Gropius ou de Moholy-Nagy ? Je n’ai que des fragments de réponse, mais peut-être que ce ne sont pas justement ces réponses qu’il faut chercher… Ces non-sus ne sont pas forcément à combler dans une histoire comme la sienne. Ils existent, ils sont là et il faut les dépasser.”
À lire aussi : Rétrovision : Les icônes du Bauhaus