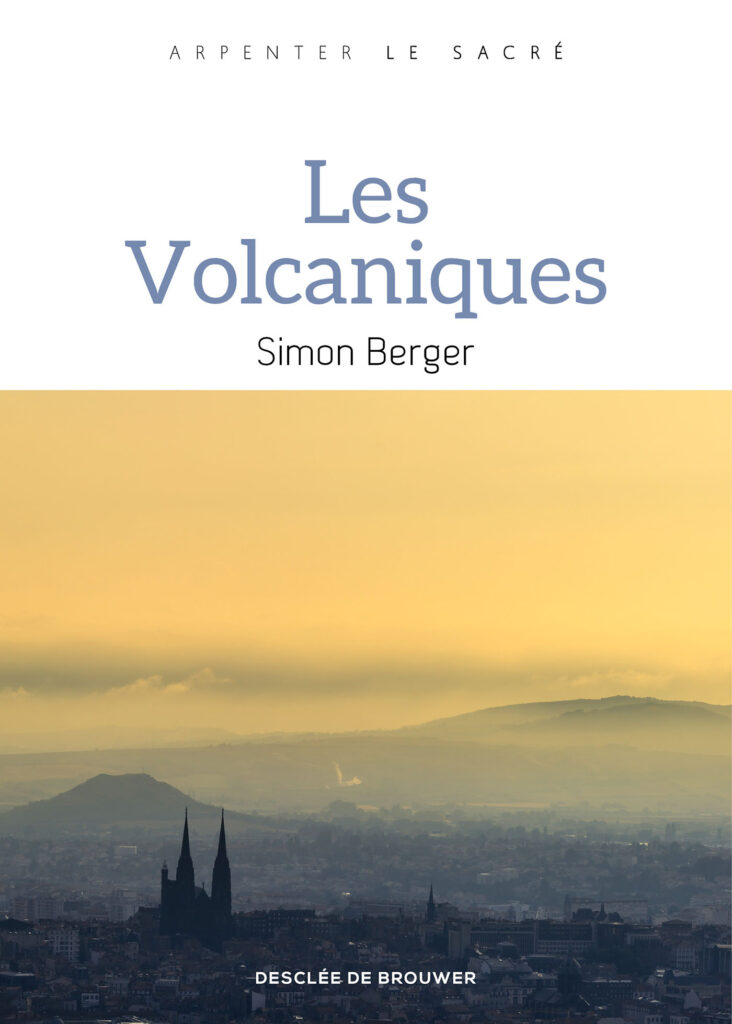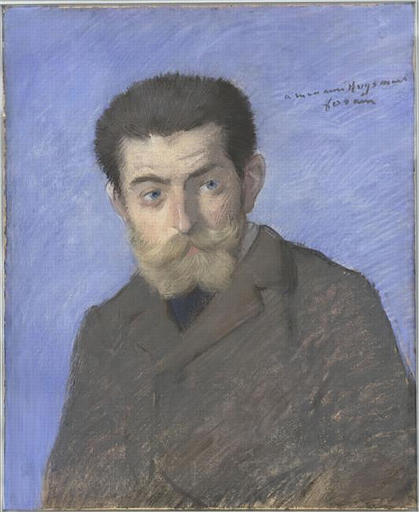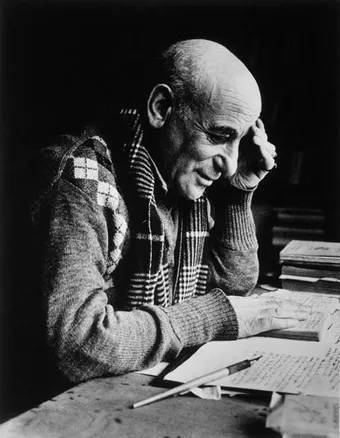Normalien en philosophie et jeune auteur de deux romans, Laisse aller ton serviteur (José Corti, 2020) et Jacob (Gallimard, 2021), Simon Berger a récemment publié Les Volcaniques, ensemble de huit méditations écrites à la première personne à propos de l’Auvergne, ses pierres et ses églises, ses écrivains et ses moines. Peuplés de monuments gothiques, de musique baroque et de personnages bibliques, ses deux premiers romans présentaient déjà le récit de plusieurs quêtes : spirituelle, artistique, filiale, littéraire. À mi-chemin entre le Cantique des cantiques et les Bucoliques, son nouvel ouvrage manifeste ses inspirations, en architecture et en musique autant qu’en littérature, et l’attention particulière qu’il porte à l’art romanesque de la description.
PHILITT : Laisse aller ton serviteur s’ouvre sur Arnstadt, Jacob sur la mairie de Clermont, Les Volcaniques sur sa cathédrale. Pourquoi une telle passion littéraire pour les pierres, et notamment pour les pierres des églises ?
Simon Berger : Tous les thèmes que j’ai essayé de développer sont dans les pierres : la transmission, les générations passées, les morts. Les pierres ont été construites pour accueillir la vie d’hommes et de femmes qui maintenant sont morts. Voilà le paradoxe qui nourrit mes textes. Même les pierres mortes sont des pierres vives : elles gardent la mémoire de ceux qui sont passés. Ces vies passées ne sont pour nous aujourd’hui que des pierres mortes, des pierres sur lesquelles on se recueille, et parfois des pierres qu’on oublie ou qu’on enlève. La pierre est un lieu de mémoire, quelque chose qui nous oblige et qui fait se lever un passé, un monde.
Dans les Volcaniques, j’ai choisi d’arrêter mon regard sur Clermont-Ferrand, ville où j’ai grandi, ville paradoxale aussi, puisqu’elle ouvre toujours sur la nature. Depuis Clermont, on voit les volcans dans un face-à-face perpétuel. La campagne est à portée de main. Et la pierre auvergnate, la pierre de Volvic, est une pierre noire qui semble fragile, instable, poreuse, et dans laquelle on a pourtant construit des choses si édifiantes, si élevées. Mais Clermont est aussi une de ces nombreuses villes où la pierre a été maltraitée, démolie pour des raisons économiques, sans personne pour s’élever contre cette démolition. Je crois qu’il y a des droits de la pierre comme il y a des droits de l’homme. On ne peut pas séparer catégoriquement les hommes des pierres qu’ils construisent pour les habiter : elles sont investies d’un esprit. Certes, l’esprit ne se résume pas à la pierre. Dieu n’est pas réductible à son temple, dirait la théologie biblique : Il l’excède, Il le dépasse, le transcende. Malgré tout, il faut bien un temple pour l’homme afin de manifester sa finitude. L’homme fini a besoin de la clôture de pierres pour pouvoir se relier à ce qui le dépasse. L’architecture est donc la marque de notre finitude : elle doit être respectée comme ayant la dignité d’un enfant de l’homme. Les gens qui ont bafoué les droits des pierres sont presque aussi criminels que ceux qui bafouent les droits de l’homme. À Clermont, l’exemple le plus frappant est la maison de Pascal ou, plus discret, un très bel ensemble d’Ancien Régime bousillé il y a quelques années pour construire un hôtel de département d’une laideur confondante. L’architecture n’ayant d’autre critère que celui de l’utilité, aux yeux des édiles, on détruit le beau et on construit de l’utile. Regardez ce qu’a fait le baron Haussmann à Paris…
Il y a une espèce de va-et-vient ou de rebond : les hommes font le décor et le décor les fait. C’est une lapalissade, mais on voit bien qu’un certain tempérament, par exemple, a donné l’art roman auvergnat. J’aime cette espèce de primitivité et d’austérité du roman, à la fois trapu et élégant. Quand on grandit à l’ombre de ces clochers, il est difficile de penser que cela n’influence pas, d’une manière ou d’une autre, notre manière d’appréhender le monde. Je suis né dans une ville où la pierre est noire. On a l’image d’une France à la pierre claire, à Paris ou dans le midi. À Clermont, il y a cet hapax d’une cathédrale noire. On dit que le gothique est l’art de la lumière, qui doit conduire la clarté. La cathédrale de Clermont nous fait entrer dans l’épaisseur de la nuit, dans un théâtre d’ombres. La question est donc de savoir ce que l’Auvergne a voulu nous dire, en construisant la cathédrale de Clermont, du « Dieu-lumière » gothique. J’aurais pu écrire Jacob à Poitiers ou à Bar-le-Duc, mais le roman n’aurait pas eu la même tonalité, les mêmes inflexions, tout simplement parce que les gens ne sont pas plus déplaçables que les monuments, y compris les nomades. Bon gré mal gré, eux aussi sont faits par les endroits qu’ils traversent, eux aussi sont pris par le charme de la pierre. Le fait que leur vie soit consacrée à y échapper dit d’ailleurs quelque chose de ce charme, de cette attraction. L’architecture nous happe : on ne soupçonne pas à quel point les rues qu’on arpente nous déterminent.
Les cathédrales et autres églises ont inspiré de nombreux écrivains (Proust, Barrès, Huysmans etc.). Quelles ont été vos influences dans cet exercice littéraire ?
Je pense qu’il est temps de réhabiliter la description. Il n’y a rien de plus vivant qu’une bonne description. À dix ou douze ans, lorsque j’ai lu Le Lion de Kessel, j’ai été marqué par la page où Kessel décrit l’arrivée des Masaï : description vivante et active, tout sauf statique, et qui nous communique une couleur, un ton, une musique. Tout surgit avec la même énergie que la vie. Il m’a semblé que Kessel, dans cette page, coiffait au poteau tous les écrivains de l’action. Une vraie description n’est pas un acte d’état civil, un état des lieux. C’est la manière dont un vivant s’approprie un lieu. C’est le pari que je me suis lancé en écrivant sur la cathédrale, que je connais bien. Laisser monter en soi des images, des comparaisons avec d’autres lieux, et essayer de restituer sa vie intérieure, son fourmillement, sa petite organisation interne. Les parties d’une cathédrale ont quelque chose d’organique. C’est ce mouvement dans un édifice statique qui m’a intéressé.
Ici réside peut-être la limite de La Cathédrale de Huysmans, écrivain pour qui, par ailleurs, j’ai une admiration immense : il reste trop proche du catalogue touristique qui quadrille, morcelle la cathédrale, l’autopsie et finit par la tuer – l’autopsie devenant l’arme du crime ! Ce qui m’aurait intéressé, c’est que le Huysmans d’En route me décrive la cathédrale : un Huysmans qui doute, un Durtal de l’atermoiement et pas un Huysmans dogmatique déjà bien converti. Finalement, on a l’impression qu’une fois qu’il s’est approprié la cathédrale par sa conversion, le mystère se dissipe. Ce que j’ai essayé de faire dans les Volcaniques – attention, sans prétendre dépasser Huysmans, tant s’en faut ! –, c’est de ramasser la cathédrale dans sa vie organique. C’est la raison pour laquelle je la compare d’entrée de jeu avec une vivante, la « Bien-Aimée » du Cantique des cantiques qui vit, qui aime, qui boit, qui mange et qui dit : « Je suis noire mais je suis belle ». Ce qui m’intéresse dans Notre-Dame, c’est de voir la dame.
La description manifeste la gratitude qu’on éprouve à l’égard des lieux, à l’égard de cette vie qui nous accueille, dans laquelle on tente de loger notre petite vie, nos petites pierres vivantes. Un de mes romans favoris est Salammbô qui est, on le sait, une description sur trois cents pages, une espèce de tableau halluciné où il ne se passe rien. Pourvu que ce soit bien écrit, peu importe qu’il se passe ou non quelque chose. C’est pour cela que je préfère Flaubert à Balzac. Cela dit, il est souvent plus facile de décrire une maison que de dire que tel personnage en ouvre la porte. On a toujours l’impression de ne pas être à la hauteur de l’action, de la sous-écrire ou de la sur-écrire. J’aime le caractère musical et expressif de la description. Par exemple, cette musique me manque cruellement chez Proust. J’ai toujours le sentiment qu’il écrit plus pour l’œil que pour l’oreille. J’aime les écrivains qui écrivent pour l’oreille. J’aime la phrase de Céline, d’Albert Cohen, de Flaubert, parce qu’ils font de la musique. Cela me plaît plus immédiatement que Proust qui me paraît très cérébral et analyste. Il est plus l’écrivain de l’analyse de la sensation que celui de la sensation en tant que telle. En littérature, je préfère croire plutôt que savoir.
Dans votre second roman, Jacob, le personnage principal a une figure paternelle pour chaque époque de sa courte vie : son père selon la chair, bien vite « détrôné » par l’abbé Vallée qui lui enseigne le catéchisme puis par Joseph Désarméniens qui veut faire de Jacob « l’enfant de son étude ». De quelle réalité existentielle le père est-il la figure ?
Mes deux premiers romans interrogent une double filiation ou transmission : un jeune compositeur qui se cherche un maître et s’invente avec lui une filiation ; un nomade qui trouve une sorte de figure paternelle de substitution. Dans Jacob, cette tentative est réduite à néant par le fait que le personnage choisit son identité et revient parmi les siens. Le cercle se referme une fois qu’il a été parcouru en entier. Il commence par l’enfance, âge sans le langage sur lequel se greffe un catéchisme sans doute un peu sommaire du début du XXe siècle. Puis, a lieu la rencontre avec Joseph, une sorte de dandy de la ville, qui tente de le « sortir de son déterminisme », comme on dirait aujourd’hui. Après avoir parcouru ce cercle, qui est au fond le cercle du salut – salut à la fois transcendant et mondain : « sortir de son milieu » –, Jacob décide de revivre sa vie à la première personne et de revenir parmi les siens. En choisissant sa vie, il choisit sa mort. En cela, c’est un personnage tragique qui regarde la mort dans les yeux. Après avoir fait le tour de ce qui aurait pu le rattacher à la vie, il fait le geste de choisir ce qu’il avait sous le nez dès le début, mais désormais en connaissance de cause. Choisir d’accepter ce qu’il ne pouvait faire autrement qu’accepter auparavant, mais librement cette fois. Ce n’est pas un suicide. Jacob assume et va jusqu’au bout de la possibilité d’être sauvé et au bout de sa vie terrestre. En cela, il y a une naïveté primitive qui s’est augmentée d’un savoir positif et, par ce savoir, il y a un retour à la naïveté. Maintenant qu’il est devenu un homme, il veut vivre sa vie, endosser la responsabilité de son destin d’homme.
Du point de vue biblique, Jacob est aussi une figure paternelle : il est, on le sait, l’ancêtre d’Israël. Le divin de Jacob est donc presque exclusivement vétéro-testamentaire. D’abord par son prénom, même s’il y a une inversion de la filiation biblique, puisque Joseph devient le père de Jacob alors qu’il en est, dans la Bible, le fils. Comme dans l’histoire d’Israël, ou presque, l’élection est ici malédiction, du moins elle est lourde à porter. Jacob fait l’expérience de la grâce, ne serait-ce que d’un point de vue physique : il est beau, d’une beauté injuste qui le fait remarquer par Joseph. Il a la possibilité de recevoir aussi la grâce de l’élévation sociale. Et comme tous ceux qui reçoivent une grâce, il meurt jeune, prématurément fauché. Dieu est un moissonneur jaloux : il garde sa moisson jalousement et la fauche très vite. Jacob a cette grâce maudite, en un sens, celle du héros à la nuque raide. Il est tellement aimé de Dieu que Dieu le rappelle très vite à Lui. L’amour divin va pour lui jusqu’à l’anéantissement. En ce sens, Jacob est proche de Job, ou des figures de la mythologie antique où les héros aimés des dieux ne meurent jamais bien vieux.
Glosée ou citée, la littérature biblique – notamment l’Ancien Testament – occupe une place de choix dans vos livres, aussi bien dans la fugue – au sens propre – de Bach dans Laisse aller ton serviteur que dans le pèlerinage littéraire des Volcaniques, en passant par le nom des personnages de Jacob. Que doit votre écriture à l’Écriture ?
L’Ancien Testament dit presque tout de notre humanité – dans ce « presque » sont contenues les vingt-sept livres du Nouveau Testament, quand même ! À divers titres. Du point de vue de la forme, d’abord : le Cantique des cantiques, un des plus beaux livres de la Bible, est le sous-texte des Volcaniques. Plus profondément, le chrétien n’est pas marcionite : il ne refuse pas l’Ancien Testament mais le considère à la lumière du Nouveau. C’est la très belle phrase de saint Augustin : « Le Nouveau Testament est latent dans l’Ancien, l’Ancien est patent dans le Nouveau ». Dans l’histoire de l’Ancien Testament, c’est toute l’histoire du salut de l’humanité qui se prépare : non pas au détriment du peuple juif, mais par lui. L’économie du salut ne peut que dépasser un peuple, transcender les communautés, mais elle ne les gruge par pour autant. Depuis l’avènement du Christ, Israël s’est étendu au monde, Israël a pris la dimension exacte de l’humanité. Ce n’est pas tant qu’il n’y a plus de Juifs, c’est que tout le monde est juif. L’élection divine est étendue à l’humanité, ce qui était en germe dès le début dans l’histoire du peuple juif. « Le salut vient des Juifs », lit-on chez saint Jean.
Rien de ce vieux livre n’est donc aboli. Il a reçu une actualité saisissante depuis la venue du Christ. William Blake dit de la Bible qu’elle est « the great code of art ». Littérairement, on est bouleversé par la poésie des cantiques, le rythme binaire des psaumes, la puissance quasiment hallucinée des images prophétiques. En bonne théologie, le beau véhicule le vrai. L’éternité de la phrase biblique nous donne une leçon de style et, en même temps, d’humilité. Le langage biblique n’est ni cuistre ni obscur, même si le sens ne se donne pas toujours d’un coup. L’avertissement de l’Ecclésiaste est décisif : tout a été dit, il n’y a plus rien d’inédit sous le soleil, rien d’original. Partant, autant puiser les mots à leur source la plus pure et la plus claire. « Tous les fleuves coulent vers la mer et la mer n’est pas remplie ». Plutôt qu’une tétanisation ou une pétrification de toute volonté de créer, je crois que cette intuition est une invitation à écrire. Si tout est vain, alors s’ouvre le temps de la jubilation. Puisque tout est vanité, faisons en sorte que sous ce soleil, les choses qui ne sont jamais nouvelles continuent d’exprimer ces premières intuitions et correspondent à chaque fois à la sensibilité qui les tamise, qui les véhicule, qui les reçoit et qui en est témoin. Devant l’évidence de la mort terrestre, de la mort physique, il nous faut cultiver les jouissances de l’esprit et la pureté du geste créateur. Que de livres à lire pour meubler notre exil, que de choses à écrire ! Le monde et la vie humaine sont bien trop fragiles pour les laisser à la perdition. La beauté ne vient jamais seule : elle témoigne toujours de quelque chose qui la dépasse. Il y a là un émerveillement enfantin, mais je crois qu’on écrit pour émerveiller l’enfant qu’on n’a jamais cessé d’être. On écrit pour faire s’écarquiller les yeux des enfants.
Par ailleurs, le parallèle que je tisse entre les Auvergnats et les Juifs dans Jacob n’est pas fortuit. L’Auvergne a quelque chose d’une terre d’exil. On parle sans cesse de la « diagonale du vide », détestable expression ! Terre d’exil pour certains, donc : terre rude aussi, quoiqu’un peu plus verte que Canaan. J’y trouve aussi, dans certaines formules paysannes dont je rends compte dans mon livre, une espèce de rigueur morale que je rattache plutôt à Marc Aurèle et aux stoïciens – mais les chrétiens ont été les premiers à récupérer le stoïcisme. Je suis frappé par ce parallèle qui culmine dans la tragédie du dernier chapitre des Volcaniques, en pleine Seconde Guerre mondiale. Il naît d’une coïncidence historique : mon arrière-grand-père a été fait prisonnier à Orléans en 1940 par les Allemands tandis que, à trente kilomètres de là, Max Jacob disait ses dernières prières avant d’être arrêté en 1944. Ces deux hommes, un Juif breton et un Auvergnat de tradition chrétienne, ont été tous les deux broyés par la même machine diabolique. On n’a jamais mieux senti que dans ces circonstances tragiques la parenté intime des victimes et l’extension d’Israël, sans oublier toutefois que les Juifs étaient la cible principale du génocide. En épigraphe à Autrement qu’être, Lévinas écrit que toutes les victimes de la barbarie nazie ont été victimes « du même antisémitisme ». Cet antisémitisme résidait au fond dans la haine de la faiblesse de l’homme, haine de sa vulnérabilité. En cela, Autrement qu’être est quasiment un livre sur l’extension du judaïsme à l’humanité.
Dans Laisse aller ton serviteur, vous écrivez de Bach qu’il est le « phare dans la nuit de nos errements » et la « cause principale de [vos] insomnies ». Pourquoi avoir écrit sur Bach dont la vie, selon vos propres mots, « n’est pas romanesque » ?
La vie de Bach, comme souvent celle des créateurs géniaux, est moins intéressante que son œuvre. C’est aussi le cas de Racine, par exemple… Mais au milieu d’une vie somme toute assez rangée, il y a cette geste folle, magnifique, de l’expédition à Lübeck. Bach n’a que vingt ans : et on a parfois du mal à imaginer la jeunesse d’un génie, à moins bien sûr d’avoir affaire à une figure rimbaldienne, jeune, géniale et foudroyée dans son jeune âge. Bach a vieilli mari et père de famille, cela sied moins à la mythologie romantique… Et son voyage à Lübeck, d’ailleurs, va à l’encontre de l’idée moderne du génie : Bach ne décide de s’affranchir des conventions que pour aller se chercher un maître. Il rompt avec l’ordre pour obéir à un ordre supérieur : ce sera Buxtehude plutôt que le consistoire d’Arnstadt. Le génie n’est pas un astre sans galaxie ; il y a une généalogie de l’acte créateur, et même le geste qu’on pourrait croire spontané est précédé de toute une histoire plus ou moins obscure, mais décisive. Bach a senti qu’il devait faire allégeance à Buxtehude pour accéder à son propre langage musical. Un artiste honnête sait ce qu’il doit et à qui il le doit. Que sont, dès lors, quatre cents kilomètres et la neige ?
Voilà donc le petit pas de côté que j’ai fait par rapport à la quasi-absence de romanesque dans la vie de Bach. Si Bach n’a pas eu, dans l’ensemble, une vie romanesque, c’est parce que cette vie s’est bâtie sur quelques actes qui, eux, ont la noblesse et la perfection des gestes de roman. Au début du XVIIIe siècle, cette marche dans la neige, c’est une chanson du Moyen Âge, c’est la Légende dorée de la musique occidentale !
Dans la querelle luthérienne entre la musique et Dieu, « face-à-face de deux absolus », votre Bach soutient qu’« on prie la même chose en priant Dieu et la musique ». Quelle place tient la musique dans la vision du monde et de Dieu d’un Bach, compositeur auquel, selon la formule célèbre de Cioran, « Dieu doit tout » ?
Querelle d’ailleurs plutôt imaginaire, puisqu’on sait la place de choix que Luther donne à la musique dans la vie cultuelle. J’ai voulu mettre en scène un Bach un peu adolescent dans son idolâtrie de la musique ; évidemment, il paraît aberrant pour un chrétien de dire que l’on prie la musique : on prie avec elle, par elle, mais elle ne peut se substituer, comme un fétiche, à Dieu vers Qui seul peuvent monter les prières. Cependant, la forme de la prière doit se montrer digne de Celui à Qui elle s’adresse : c’est pourquoi il y a de bonnes et de mauvaises liturgies comme il y a de bonnes et de mauvaises prières. La musique, les gestes, ne sont pas des coquilles vides, des formes creuses : ils expriment déjà quelque chose du contenu de la foi. Cela ne signifie pas qu’une belle musique traduit nécessairement une foi juste, mais plutôt qu’une foi droite ne peut s’exprimer que par une musique digne.
En cela, la musique religieuse est un formidable moyen de conversion, et Cioran a raison ! Du moins, je ne sais pas si Dieu doit vraiment tout à Bach, mais, ainsi que je l’évoque dans les Volcaniques, Il lui doit au moins ma conversion, à lui et plus encore à Buxtehude… L’émotion esthétique ébranle la sensibilité et, par la suite, quelque chose en nous – la raison ? – discerne, s’il y est, le contenu dogmatique – ou kérygmatique, comme on aime à dire aujourd’hui – de cette « révélation ». On peut se convertir par la musique protestante – émotion esthétique – sans pour autant en adopter la foi – discernement de la raison. Mais il faut donner raison à Bach, qui terminait certaines de ses partitions sacrées par les mots Soli Deo gloria. La dimension apologétique de l’art n’est pas négligeable, et elle demeure à réinvestir.
Le génie de Bach est d’avoir composé, au moyen d’une ascèse intellectuelle et réfléchie, une musique d’une beauté évidente et simple. Il ne nous impose pas son génie contrapunctique. C’est cette ligne de crête qui m’intéresse : la rigueur de l’étude et la simplicité des sentiments exprimés. L’un ne va pas sans l’autre. Une littérature qui exprimerait des sentiments sans la rigueur de la syntaxe et de la grammaire serait une littérature avachie. Mais une littérature qui ne serait que de la syntaxe sans émotion serait, sinon de la littérature allemande, du moins quelque chose de très didactique et qui sortirait du champ de la littérature. Un bon essai philosophique ne peut pas, lui non plus, faire l’économie de la sensibilité. Ne pas négliger l’ordre dans la sensation ni l’émotion dans le système : c’est ce chiasme qui m’intéresse. Dans les Volcaniques, je parle de cette ligne de crête entre la Somme de théologie et le bulletin paroissial. En musique, je pense par exemple aux Litanies à la Vierge noire de Poulenc. C’est une pièce écrite par une « fille de ferme » qui aurait fait des études de contrepoint. Les études de contrepoint n’ont pas anesthésié la fille de ferme et la fille de ferme n’a pas été insensible au contrepoint. À un certain moment, l’extrême rigueur de l’étude finit par retomber dans la sensation.
À travers la rencontre d’un maître, Buxtehude, et de son disciple, Bach, vous offrez une réflexion approfondie sur le mystère de la création artistique, dessinant une analogie discrète – et classique – entre l’acte créateur et rédempteur de Dieu et celui de l’artiste, qui continue l’œuvre de Dieu. « Dieu n’a pas bouché tous les trous de Sa création : c’est la musique qui s’en devait charger », écrivez-vous dans Laisse aller ton serviteur. L’artiste a-t-il comme vocation d’achever la création ? En a-t-il les moyens ?
Là encore, je place cette terrible remarque sur les « trous de la Création » dans la bouche théorique des autorités et des fidèles d’Arnstadt. Il est vrai qu’on n’a pas de peine à se figurer une pratique assez bourgeoise de la religion dans ces villes allemandes du début du XVIIIe siècle : j’en ai fait une incarnation de la tiédeur – peut-être injustement, mais il fallait, pour souligner l’ardeur du jeune Bach, un contrepoint de mollesse et de confort bourgeois, une sorte d’hydre chabrolienne au milieu de la Thuringe… Et il se trouve qu’on a réellement reproché à Bach les changements de son style après sa rencontre avec Buxtehude : le stylus phantasticus du maître de Lübeck dérangeait la foi tiède d’Arnstadt…
Je crois pour ma part que l’asymétrie radicale entre la Création divine et le geste créateur humain interdit les parallèles trop hardis. L’art est un plaisir de la finitude ; et Dieu ne finit pas, comme le dit Pierre Michon avec tout ce que cette belle phrase comporte d’étrange ambiguïté. L’art se place dans la Création divine comme une vaste note de bas de page, ou, pour le dire avec Gracq, un addendum, une plante épiphyte sans cesse s’enlaçant au tronc divin, mais qui ne le rejoindra qu’au prix de la subversion du monde.
Si cet article vous a plu, vous pouvez soutenir PHILITT sur Tipeee.